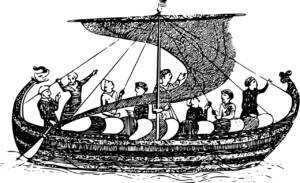
Les drakkars. Les terribles vaisseaux à tête de dragon des Vikings, ceux dont la vision terrifiait tout l’Occident, surgissant de la brume pour déverser sur les rivages de terribles guerriers, prêts à mettre villes et monastères à feu et à sang…
Bon. On a déjà vu dans un article précédent que le formidable guerrier Viking, il fallait peut-être en revoir un peu l’image. Et si je vous disais qu’en plus, il n’y a jamais eu de drakkar ?
L’exception culturelle française
Remercions bien fort un homme : Augustin Jal, dans son Archéologie navale en 1840, nous pond que les « drakar/drakkar » (il utilise les deux orthographes même si seule la deuxième va perdurer) sont les navires utilisés par les Normands.
Déjà, il parle de Normands et pas de Vikings, alors on ne va pas trop lui en vouloir – mais on discutera plus avant de ce point une autre fois.
Mais il s’agit bel et bien d’une erreur de langue – drakkar n’existe tel quel dans aucune langue scandinave (on trouve, à la limite, le pluriel drakar en suédois), et ne veut certainement pas dire « vaisseau viking » !
On trouve bien le mot dreki et son pluriel drekar dans certaines sagas pour désigner des vaisseaux. Ce sont alors des bateaux particulièrement longs et remarquables, ceux des rois ou des chefs de guerre. Mais le mot de dreki est une image de leur apparence générale, pour relever à quel point elle est impressionnante ! C’est sans doute également une métonymie pour leur figure de proue figurant des animaux effrayants… des drekar, ou dragons (au passage, ce n’était pas toujours des dragons. Apparemment, ils donnaient aussi dans le lion ou le taureau, par exemple… mais sans doute pas dans le petit écureuil ou le gentil mouton)
On n’arrête pas la mode
Le problème, c’est qu’ensuite le mot « drakkar » se répand comme une traînée de poudre ! Au point que, quelques années plus tard, on le retrouve déjà dans certains dictionnaires. En 1905, il entre même dans le Larousse, et là c’est la fin, tout le monde se met à l’utiliser. Aujourd’hui même ceux qui ne s’intéressent pas du tout à cette époque connaissent deux mots : viking et drakkar. C’est même devenu un nom de parfum.
De parfum.
Enfin, quand je dis que tout le monde l’utilise… tout le monde en France. Non, parce que tentez de dire « drakkar » à un Danois, un Islandais ou même un Anglais, et ils ne risquent pas de penser aux célèbres bateaux de cette époque !
En fait je ne suis pas sûre qu’ils fassent autre chose que vous regarder bizarrement. Surtout l’Anglais, mais on sait tous que les Anglais n’ont pas digéré de s’être faits ratatiner par Guillaume le Conquérant, donc on ne s’attendra pas à ce qu’ils fassent le moindre effort.
Très bien, mais alors on dit quoi ?
Eh bien déjà, il existe différents types de navires, mentionnés dans les sagas et retrouvés ou reconstitués grâce aux recherches archéologiques… accrochez-vous parce que nos navigateurs du Nord étaient pointilleux sur le vocabulaire.
- skip, le navire de manière générale
- bàtr, la barque ou le canot
- herskip, le navire de guerre,
- langskip, le navire long,
- kaupskip, le navire marchand (oui ça commence à faire beaucoup de skips, attention préparez-vous on va varier)
- la skeið, un type de langskip souvent décrit dans les batailles des sagas
- la snekkja, plus petite et tardive, aussi utilisée pour les batailles
- le knorr, navire de charge (qui ne transportait sans doute pas de soupe en boîte, je sais que j’écris des uchronies mais n’abusons pas des bonnes choses)
- la skuta, petit bateau de cabotage,
- et j’en passe !
Comme d’habitude quand on laisse un groupe d’humains développer un peu trop un domaine donné, ils se lâchent sur le jargon, que voulez-vous, c’est un problème communément observé. Au moins ça occupe les linguistes.
Mais justement, si la langue est un tel vivier de vocabulaire, on va pas se contenter d’un bête emprunt à une langue étrangère, si ?
Là, c’est comme vous voyez, mais sachez que Jean Renaud relève dans son livre Les Vikings – vérités et légendes (où j’ai puisé presque toutes mes infos pour cet article et que je vous recommande) que le nom de certains de ces vaisseaux est passé en langue normande. Ainsi skeið a donné eschei, snekkja est devenu esnèque et knorr, kenar.
Alors, certes, le normand n’est plus utilisé de nos jours (enfin je ne sais pas. Normands, manifestez-vous), mais un dialecte de langue d’oil, c’est déjà un peu moins un emprunt ! On pourrait tenter de rétablir ces trois mots, pour avoir un peu plus de variété et d’authenticité… Enfin, la langue fait bien ce qu’elle veut, n’en déplaise aux linguistes et aux académiciens, donc je me dis que « drakkar » a encore de beaux jours devant lui.
En attendant, il est possible que j’essaie de caler « esnèque » dans une ou deux conversations, pour voir…
Voilà, notre petite aventure linguistique touche à sa fin. Comme toujours, n’oubliez pas que je ne suis pas historienne et que tout ce que je vous raconte provient de ma lecture de sources secondaires… mais si j’ai pu vous apprendre quelque chose, tant mieux ! Et si vous avez quelque chose à m’apprendre, n’hésitez pas à faire un tour dans les commentaires 🙂

Laisser un commentaire