Un Noël en Normandie

Le Danemark, c’était clairement décevant. Déjà, Mathilde avait promis qu’il y faisait plus chaud qu’en Islande. Manque de chance, ils y étaient au mois de décembre, donc pour la chaleur, il fallait pas trop rêver. Joséphine n’avait jamais autant voulu repartir en Guyane que durant ce séjour. La reine Christine leur faisait peut-être un grand honneur en les accueillant au palais pour une des conférences de Mathilde et Faraldr, mais est-ce que ça valait vraiment le coup de perdre tous leurs orteils ?
— Joséphine, n’exagérons rien, la morigéna Mathilde. Il faut des températures bien inférieures pour courir des risques d’engelures.
— Si vous le dites. Bon, maintenant qu’on a fini de parler aux universitaires, on peut rentrer ?
— Je ne savais pas que vous étiez aussi attachée au climat normand, lança Armand, hilare.
Joséphine le foudroya du regard avant de chercher quelque chose à lui jeter à la figure. Une boule de neige, peut-être ?
Mais elle n’en eut pas le temps, car au même moment, Jón Islendigur en personne apparut enfin dans la cour.
— Jón ! s’exclama Faraldr en l’agrippant dans une accolade enthousiaste.
Puis Joséphine renonça à suivre la conversation, car ils se mirent aussitôt à parler islandais, bien entendu – Jón ne repassant au français que pour les saluer, elle et Armand, pauvres néophytes en langues scandinaves.
Ils n’avaient pas revu l’Islandais depuis leur départ de Reykjavík : eux avaient été occupés par la série de conférences que Mathilde et son professeur avaient organisées dans toute l’Europe pour Faraldr, tandis que lui avait pris sa place de conseiller de la reine Christine du Danemark.
— Mes amis, c’est vraiment un plaisir de vous retrouver. J’aurais préféré que ce soit en Islande, mais cela fait des mois que je n’ai plus eu l’occasion de m’y rendre. Venez : un restaurant islandais a justement ouvert récemment, c’est à deux pas. Je vous y emmène.
— Votre sœur va-t-elle bien ? demanda Mathilde pendant qu’ils se mettaient en route.
— Très bien. Elle m’a chargé dans sa dernière lettre de vous transmettre ses salutations, entre deux injonctions sur ce que je dois faire à la cour de Sa Majesté.
Joséphine ricana dans sa barbe, pas étonnée pour un sou. Guðrún avait une sacrée trempe.
Le restaurant avait une belle devanture ornée de peintures colorées qui rappelaient les broderies des robes islandaises. Surtout, il faisait bien meilleur à l’intérieur, et Joséphine poussa un soupir de bien-être. Deux jeunes femmes les y accueillirent pour les mener vers une table où une troisième se leva en les voyant arriver.
— Je vous présente Ane Madsen, qui m’assiste à l’occasion comme secrétaire. Mademoiselle Madsen est une très bonne linguiste. elle parle à présent presque couramment islandais, et son français ne demande que votre compagnie pour se perfectionner.
Mademoiselle Madsen était une Danoise tout ce qu’il y avait de plus traditionnel, avec des cheveux d’un blond presque blanc, les joues roses et les yeux bleus : elle semblait tout droit sortie d’un des livres de Mathilde. Elle les salua dans un français teinté d’un accent marqué, et resta ensuite sagement assise entre Jón et Mathilde, qui entama la conversation en danois – ou en islandais, pour ce que Joséphine en comprenait.
Une serveuse revint sur ces entrefaites. Elle déposa devant eux plusieurs plats, dont une sorte de soupière fermée, mais dont se dégageait tout de même une odeur pestilentielle. Joséphine retroussa les lèvres.
— Ça, ça a l’air dangereux.
— Juste un mets traditionnel, pour lequel je voulais demander à Faraldr s’il le connaissait déjà, répondit Islendigur avec un sourire beaucoup trop roublard au goût de Joséphine. Du hákarl.
S’ensuivit une rapide explication en islandais, qui laissa Faraldr perplexe et Mathilde partagée entre la curiosité et l’épouvante – sans doute la pire expression qu’elle pouvait arborer, se dit Joséphine en reculant légèrement sa chaise, prête à bondir en cas de besoin. Armand s’était éclipsé pour aller remettre leurs manteaux au maître d’hôtel et revenait à peine s’asseoir. Il fut donc pris entièrement par surprise lorsque Islendigur souleva le couvercle pour révéler de petits cubes jaunes et blancs, et une odeur de pisse si atroce qu’on se serait cru dans une ruelle des docks de Nantes.
— Mais qu’est-ce que c’est que ça ?! s’exclama Armand, la main sur le nez.
— Truc traditionnel islandais, méfiez-vous, le prévint Joséphine à travers sa manche.
Mathilde défendait toujours bec et ongles tout ce qui avait trait à la culture islandaise ; c’était en général Armand qui en faisait les frais. Mais là, la tête qu’elle faisait était impayable. Joséphine se promit de remercier plus tard Jón de leur avoir offert le spectacle qui avait enfin fait vaciller son amour pour l’Islande.
Si elle survivait à l’épreuve, bien sûr.
— C’est du requin mariné et séché, leur expliqua Jon. Une spécialité unique à notre île. La chair des requins que l’on y trouve est en effet toxique si on ne la traite pas selon ce procédé. Il est réputé être très ancien.
— Nous ne mangeais… mangions pas de requin, intervint alors Faraldr. La viande était dangereuse. Mortelle.
Jón parut déçu, Mathilde fascinée ; Joséphine, quant à elle, était plutôt soulagée de savoir que Faraldr n’avait pas passé des années de sa vie à se nourrir de ce truc.
Ce qui n’empêcha pas Jón de leur donner à tous un petit cube puant.
— Je vous en prie, goûtez. On boit traditionnellement du brennivín avec cela, ajouta-t-il tandis que la serveuse déposait des verres devant eux. Je comparerais cela à un fromage très fort. Je suis sûr qu’en tant que Français, vous aurez le discernement nécessaire pour l’apprécier.
Armand grimaça, mais Jón venait sans doute de trouver le seul moyen de le convaincre de goûter, réalisa Joséphine, hilare. Mathilde allait bien sûr tenter le coup simplement parce qu’il s’agissait d’un plat scandinave, et Faraldr était d’un naturel plutôt curieux, même s’il semblait dubitatif. Quant à elle, elle avait pour philosophie que tant que ça avait bougé un jour, ça devait bien se manger. Elle n’avait eu trop faim au cours de sa vie pour apprendre à faire la fine bouche. La Danoise, en revanche, fixait son assiette d’un air horrifié – apparemment, le rapprochement dano-islandais n’avait pas encore inclus certaines choses.
Ils goûtèrent donc. C’était… Joséphine n’était pas sûre que « fort » était le mot qui convenait. Elle avait l’impression que l’odeur terrible s’était insinuée dans sa bouche et jusqu’à son cerveau, qu’elle s’y était logée et n’en sortirait plus jamais. Avaler le cube somme toute assez petit lui prit plusieurs essais, et elle se précipita sur son brennivín pour tenter de faire passer les choses. Faraldr avait adopté la même technique, et il fixait à présent le plat d’un air effrayé. Jón, bien sûr, ne bronchait pas, mais il avait toujours su bluffer. Armand… Armand était un train de s’étouffer sur son verre d’alcool. Faraldr dut lui asséner de grandes claques dans le dos pour l’aider à s’en sortir.
En fin de compte, seule Mathilde s’illustra ; une belle démonstration soit de l’éducation d’une dame de la haute, soit, plus probablement, de son entêtement normand. Elle ne broncha pas, ne but qu’une toute petite gorgée d’alcool, et se tourna vers Jón avec un sourire.
— Voilà un goût très intéressant. Oh, vous n’en voulez pas ? ajouta-t-elle à l’intention de la Danoise, qui la regarda aussitôt d’un air terrifié.
Joséphine étouffa un rire dans sa serviette. Si cette gamine devait côtoyer Jón, il allait falloir qu’elle s’endurcisse un peu.
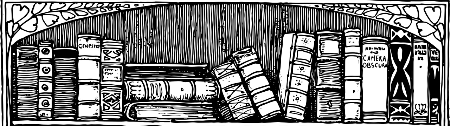
Revoir Jón avait été un plaisir, mais leur séjour à Copenhague toucha rapidement à sa fin. Ils embarquèrent à nouveau à bord de Sleipnir et rejoignirent Caen, où ils devaient prendre quelques jours pour se reposer et profiter des fêtes de Noël. Ses parents donnaient toujours un superbe bal à cette occasion, et cette année Mathilde avait décidé d’organiser une petite surprise en prime pour Faraldr. Il ne se plaignait pas, mais elle voyait bien que se retrouver si loin de tout ce qu’il connaissait lui pesait parfois. À défaut de pouvoir lui permettre de rentrer chez lui, elle comptait bien lui donner matière à apprécier le XIXe siècle.
Ils se posèrent comme toujours dans le champ privé à l’extérieur de la ville, avant de rejoindre la maison en fiacre. Durant le trajet, un débat s’engagea. Apparemment, Armand et Joséphine avaient fait un pari sur le temps qu’il leur faudrait pour arriver à Caen depuis Copenhague. Mathilde refusa fermement d’écouter leurs sottises : depuis six mois qu’ils voyageaient ensemble, on aurait pu penser qu’ils auraient acquis un peu de maturité, mais non. Ils continuaient à enchaîner les bisbilles les plus futiles.
Elle n’intervint que lorsque le fiacre s’arrêta, et encore, seulement parce qu’elle ne voulait pas qu’ils se ridiculisent devant le cocher.
— Une ville est pas dans le ciel, que je sache. Si on avait apponté sur une tour, à la rigueur. On est entrés dans Caen à bord de ce fiacre, et il était déjà presque vingt heures.
— Les termes de l’engagement étaient très clairs ! Est-ce ma faute si vous autres civils êtes incapables de comprendre la notion de frontières aériennes ? Nous avons franchi les limites de Caen à dix-neuf heures, et rien de ce que vous…
— Armand, l’interrompit Mathilde. Il me semble que tu es toi-même un civil, à présent.
— Très juste, reconnut Armand d’un air sombre. Mais étrangement, cela ne m’empêche pas de saisir certaines idées, contrairement à certaines personnes.
— Oh, je saisis bien, rétorqua Joséphine. Je saisis que vous êtes mauvais perdant.
— Je ne vous permets pas !
— Pourrait-on s’il vous plaît descendre de ce fiacre ?
Avec l’aide de Faraldr, Mathilde parvint à extraire les deux belligérants de la voiture ; là, Armand dut fort heureusement s’occuper de payer le cocher, ce qui donna à Faraldr le temps d’emmener subtilement Joséphine vers le portail en lui posant des questions sur le vocabulaire utilisé pendant leur dispute. Mathilde était presque certaine qu’il connaissait au moins certains des mots dont il demandait la définition ; son français était chaque jour meilleur. Elle le soupçonnait d’ailleurs de se servir de ses prétendues lacunes en français lorsque cela l’avantageait, notamment face aux importuns qui voulaient l’entraîner dans des discussions assommantes.
Elle soupira en repensant à ce professeur d’Oxford qui s’était échiné à leur soutenir que sa traduction de l’Edda était correcte et que Faraldr, ayant vécu bien avant Snorri Sturluson, ne pouvait pas connaître certaines nuances de vocabulaire. Il n’avait certes pas tort, mais son pédantisme l’avait rendu proprement insupportable. Fort heureusement, tous les savants européens n’étaient pas de cet acabit… même s’il y en avait un certain nombre.
Faraldr avait presque réussi à emmener Joséphine dans la maison, où le fait de retrouver sa petite sœur lui ferait rapidement oublier toute idée de querelle, lorsque la porte s’ouvrit d’un grand coup. Ils sursautèrent tous quand Anne-Marie de Haurecourt s’encadra dans l’embrasure, une main plaquée sur la poitrine, avec un cri :
— Appelez la gendarmerie ! Nous avons été cambriolées !
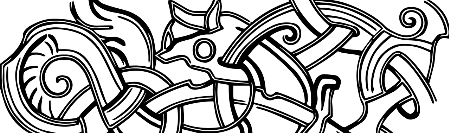
Ils trouvèrent toute la maisonnée sens dessus dessous. La cuisinière, le majordome, les trois bonnes et le valet allaient et venaient dans les escaliers tandis que des éclats de voix résonnaient dans l’air : la vieille dragonne, réalisa rapidement Faraldr. Anne-Marie les entraîna jusqu’à la porte de la bibliothèque. Là, Mathilde s’arrêta avec un cri.
Les tiroirs du grand bureau avaient été renversés par terre et un certain nombre de livres s’empilaient à présent sur le tapis et les fauteuils, laissant les étagères à moitié vides, comme éventrées. Liberté, la petite sœur de Joséphine, était agenouillée et s’efforçait de former des tas ordonnés ; Henriette d’Amoys allait et venait, les poings serrés, ses jupes menaçant de faire s’envoler les feuilles éparpillées à chaque tournant. Armand se dirigea aussitôt vers les fenêtres tandis que les deux dames de la maisonnée leur expliquaient qu’elles venaient de rentrer d’une visite et avaient trouvé la bibliothèque dans cet état. Aucun des serviteurs n’avait rien vu ni rien entendu. Faraldr rejoignit rapidement Armand, suivi par Joséphine, pendant que Mathilde tentait de calmer sa tante.
— On dirait que celle-ci a été forcée, leur apprit Armand en indiquant un montant en bois peint en jaune.
Faraldr se pencha en avant et repéra les marques laissées par un couteau ou un autre objet qui avait sans doute servi à remonter l’espagnolette. Il émit un grognement.
— Les fenêtres. Mauvaise idée. Trop d’entrées dans la maison.
— Ouais, mais c’est quand même sympa d’y voir clair, remarqua Joséphine.
— Pas besoin d’y voir clair dedans ! Il ne fait pas si froid dehors.
À ce moment précis, un coup de vent passa par le battant encore ouvert et Joséphine comme Armand frissonnèrent de concert. Faraldr retint un soupir : ces Français étaient décidément frileux.
— Va lui dire à elle qu’on a pas besoin d’y voir clair à l’intérieur, reprit Joséphine avec un signe du menton vers Mathilde.
— Vous n’avez pas tort, acquiesça Armand. Même au fin fond de l’Islande, poursuivie par un corsaire et l’armée, elle a quand même trouvé le moyen de dénicher des livres…
Faraldr haussa les épaules, mais ils avaient raison : si ces fenêtres pouvaient permettre à Mathilde de lire confortablement, alors cela valait peut-être les risques.
— Joséphine, pourriez-vous me faire passer cette lampe, je vous prie ? demanda Armand.
Elle attrapa une lampe à huile posée sur une étagère voisine avant de la lui tendre. Aussitôt, il ouvrit plus grand encore la fenêtre pour se pencher et examiner le sol, puis poussa un cri de triomphe.
— Il y a des traces de pas dehors.
— Pas étonnant s’il est entré par là, fit Joséphine.
— Ce que je voulais dire, reprit sèchement Armand, c’est que nous pourrons relever ces empreintes. Cela nous donnera peut-être une indication sur notre voleur.
— Si c’est un homme grand ? demanda Faraldr, sans vraiment comprendre l’intérêt : il y avait de nombreux habitants à Caen, cela ne suffirait pas à identifier qui que ce soit.
— Surtout s’il portait des godillots d’ouvrier ou des chaussures de ville, le corrigea Joséphine. Pas bête.
Leur conversation s’arrêta là : les gardes étaient arrivés. Ils étaient deux, l’un plutôt jeune et l’autre d’une cinquantaine d’années. D’après ce que ses amis lui avaient rapidement expliqué en se dirigeant vers le salon, ces « gendarmes » étaient chargés de faire respecter la loi.
Apparemment, ce n’était plus aux simples hommes libres de s’occuper de ce genre d’affaires du quotidien… mais d’un autre côté, il y avait beaucoup de gens en France à cette époque : nommer des personnes spécifiquement pour maintenir l’ordre était assez logique.
En tout cas, il était rassurant de voir que le vol restait un crime assez grave pour provoquer l’intérêt immédiat de ces gardes. Faraldr se doutait que la punition serait sans doute différente de ce qu’il connaissait ; il avait déjà eu l’occasion de constater, en quelques mois, qu’aucun de ses nouveaux amis n’était aussi indigné que lui face à une telle ignominie. Qu’un homme gagne des biens à la bataille, en faisant la preuve de sa force et de son courage, c’était une chose ; mais se dissimuler dans la nuit, trahir la confiance de la communauté… c’était impardonnable.
— Aucun objet de valeur, vous dites ? demandait le gendarme le plus âgé à Armand.
— Voulez-vous me redire votre nom, monsieur ? exigea alors Henriette d’Amoys en se redressant de toute sa taille.
L’homme d’armes se tourna vers elle en fronçant les sourcils et Armand fit prudemment un pas en arrière.
— Polémard, madame.
— Mademoiselle, le reprit-elle d’un ton glacial. Monsieur Polémard, dois-je vous rappeler que la bibliothèque a été retournée ? Nous ne pourrons savoir si aucune correspondance de valeur n’a été dérobée avant d’avoir pu tout rassembler.
— Ah, mademoiselle, je ne parlais pas de vos lettres de jeunesse, voyons, sourit Polémard.
Armand grimaça, Mathilde prit un air outré et Joséphine se mit à ricaner en faisant à peine l’effort de le cacher derrière sa main ; Faraldr regarda le visage d’Henriette d’Amoys s’assombrir devant l’outrage et sentit l’indignation l’envahir. Cette maison était celle de mademoiselle d’Amoys, une femme libre, riche et importante. Elle n’était peut-être pas mariée, mais ce n’était pas une raison pour lui manquer de respect.
Il se garda bien d’intervenir, cependant. Il commençait à connaître suffisamment la dame en question pour savoir que cet homme allait rapidement regretter ses paroles.
Il eut du mal à comprendre la tirade qui suivit, mais Mathilde, qui regardait la scène les yeux écarquillés, avait l’air bien trop absorbée pour lui traduire quoi que ce soit. Il saisit tout de même que les lettres qui pouvaient avoir été dérobées avaient de l’importance, car elles concernaient les affaires de la famille d’Amoys, qui s’étendaient sur toute la surface de la Terre.
Le plus jeune gendarme avait distinctement pâli ; Polémard, lui, avait commencé par rougir de colère, mais semblait s’être dégonflé à mi-chemin.
— … et voilà pourquoi, sombre imbécile, je ne pourrai savoir ce qui m’a été volé qu’après une inspection en règle ! Mais que fait donc notre préfet, à m’envoyer de pareils nigauds ! Ah, il va m’entendre. Anne-Marie, rappelle-le moi au prochain dîner, veux-tu ?
Faraldr s’était attendu à ce que Anne-Marie de Haurecourt, qui était une femme de paix toujours prête à tempérer les ardeurs de la tante de Mathilde, tente d’apaiser son courroux ; mais elle se contenta de hocher la tête sans montrer la moindre pitié pour les deux gardes, qui ne payaient à présent plus de mine.
— Eh bien… vous parliez d’une fenêtre qui aurait été forcée ?
— Je vais vous montrer, intervint Armand avant que la dragonne puisse recommencer à tempêter. Si vous voulez bien me suivre, messieurs… il y a aussi dehors des empreintes que vous pourriez relever.
Ils sortirent. Mathilde, nota Faraldr, semblait nerveuse : son regard ne cessait de voleter dans toute la pièce, comme si elle cherchait quelque chose.
— Tout va bien ? lui demanda-t-il à voix basse.
— Pardon ? Oh, oui. C’est juste… tout ça. C’est impressionnant.
Elle parut sur le point d’ajouter quelque chose, puis se mordit les lèvres. Faraldr fronça les sourcils, mais avant qu’il n’ait eu le temps de la pousser pour en savoir plus, Henriette prit la parole d’une voix forte.
— Cessons là. Vous venez d’arriver, vous devez être fatigués. Nous finirons de ranger la bibliothèque demain, avec madame Mernet. Autant que cette secrétaire serve à quelque chose.
— Enfin, Henriette, tu sais bien qu’elle nous aide beaucoup… la reprit Anne-Marie en lui emboîtant le pas dans le couloir.
Mathilde suivit sans mot dire, même si son regard s’attarda sur la porte de la bibliothèque ; mais elle refusa de répondre aux questions de Faraldr, prétextant la seule nervosité d’avoir vu leurs affaires dans un tel désordre.
Armand monta peu après et lui assura que les gendarmes et les domestiques allaient surveiller la maison pour le reste de la nuit, mais Faraldr ne dormit pas beaucoup.
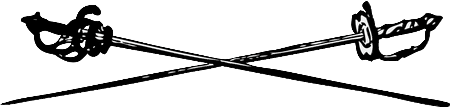
— Mathilde, demanda Armand en ouvrant la porte de la bibliothèque, aurais-tu…
Il s’interrompit en constatant que, contrairement à tout ce que dictaient la logique, la raison et l’expérience des ans, Mathilde ne se trouvait pas dans la bibliothèque. Seule madame Mernet y était, qui releva vers lui sa tête couverte de l’habituelle coiffe en dentelle.
— Mademoiselle d’Amoys n’est pas là, monsieur. Elle vient de partir avec monsieur Faraldr.
— A-t-elle dit où elle allait ?
— À la faculté, je crois… oui, il fallait qu’elle voie le professeur Martel.
— Merci, madame Mernet.
Il attrapa manteau, chapeau et cane et sortit sans attendre l’assistance d’André, qui lui en voudrait sans doute toute la journée pour ce manquement aux convenances ; le pauvre majordome était suffisamment malmené par les excentricités de la maisonnée pour pouvoir s’en remettre, mais Armand tentait en général de lui laisser une illusion de normalité.
Trouver Mathilde et Faraldr ne fut pas difficile. Le Normand aimait peu les couleurs sombres en vogue dans la mode masculine, si bien que même son manteau était d’un vert émeraude qui se détachait dans la grisaille ambiante. Armand nota en s’approchant à grands pas que Joséphine les accompagnait et sentit l’irritation l’envahir. Mathilde aurait au moins pu le prévenir de cette petite sortie de groupe.
Il les rattrapa au moment où ils arrivaient devant le concierge, un homme particulièrement indiscret du nom de Bellot, avec lequel Mathilde entretenait un conflit latent : monsieur Bellot était d’avis que les femmes n’avaient pas leur place à la faculté, ce que sa cousine n’acceptait naturellement pas.
— Bien le bonjour, monsieur Helgusson. Ah, et monsieur du Thouars, c’est toujours un plaisir…
Tous se retournèrent vers lui ; malgré tous les efforts de celle-ci, Armand vit bien que Mathilde était plus affolée que seulement surprise par sa présence et sentit la suspicion l’envahir. Que comptait-elle lui cacher au juste ? Cela avait-il un rapport avec le cambriolage de la nuit dernière ?
— Bonjour monsieur Bellot, répondit-il avec politesse.
— Dois-je appeler le professeur Martel ?
— Je ne sais pas. Mathilde ? Allons-nous voir le professeur Martel ?
Sa cousine rougit face au mordant de sa voix faussement aimable, mais se reprit bien vite.
— En effet, dit-elle en se tournant vers le concierge. Nous souhaiterions voir le professeur.
Monsieur Bellot les dévisagea tour à tour avec une étincelle d’intérêt dans le regard, toujours à l’affût du moindre ragot ; mais il finit par les laisser entrer, en prenant soin de leur indiquer le chemin jusqu’au bureau du professeur, comme toujours. Que Mathilde connaisse la faculté par cœur ne semblait jamais lui effleurer l’esprit.
Une fois arrivés dans la cour intérieure, Armand rattrapa Mathilde malgré les tentatives de sa cousine pour se dissimuler lâchement entre Faraldr et Joséphine.
— Que faisons-nous ici ?
— Rien de particulier, Armand. Nous allons voir le professeur pour… le tenir au courant des dernières nouvelles.
— J’ignorais que le professeur Martel s’intéressât tant à ce qu’il peut se passer chez ta tante.
— Vous plaisantez, le reprit Joséphine d’un ton railleur. Il est toujours fourré là-bas.
Armand lui lança un regard peu amène. Elle n’avait certes pas tort, mais son intervention ne faisait que soulager Mathilde, qui s’empressa aussitôt de traverser la cour sans demander son reste. Il la suivit sans ajouter un mot. La laisser mariner était parfois le meilleur moyen d’obtenir des réponses.
Ils trouvèrent la porte du professeur grande ouverte. Une voix monocorde s’en échappait, qui fit grimacer Mathilde autant que Faraldr. Armand échangea un regard surpris avec Joséphine, avant de se pencher en avant pour découvrir ce qui pouvait bien provoquer une telle réaction.
Un homme d’une trentaine d’années se tenait devant le bureau de Martel. C’était lui qui parlait, exposant les détails d’une saga islandaise, d’après ce qu’Armand comprit. Il avait l’apparence parfaite d’un universitaire : un lorgnon perché sur le nez, une redingote montrant des signes d’usure et des traces de craie, et dans ses bras un épais volume menaçant à tout moment de venir s’écraser sur ses pieds.
Il était si plongé dans sa déclamation qu’il ne remarqua pas leur présence ; ce ne fut pas le cas du professeur, en revanche, qui semblait s’ennuyer ferme.
— Ah ! Monsieur du Thouars… oh, et monsieur Helgusson, et mesdemoiselles… que de visites ! Vous nous excuserez, monsieur Hénin, nous devrons finir à une autre occasion. Continuez dans cette voie. Plus synthétique, peut-être, d’accord ? Merci bien. Fermez la porte derrière vous.
Le dénommé Hénin tourna vers eux des yeux furieux ; il fallait dire que le professeur Martel n’était jamais des plus subtils et que les convenances les plus élémentaires de la vie sociale semblaient lui être aussi étrangères qu’à Henriette d’Amoys. Armand fut cependant surpris de constater que Faraldr lui rendait son regard avec hostilité, tandis que Mathilde se détournait ostensiblement pour rajuster un livre sur une étagère. Il y avait là une histoire qu’il ne connaissait pas.
Décidément, sa journée s’annonçait remplie de mystères.
Hénin finit par débarrasser le plancher, non sans s’attirer les foudres de Joséphine lorsqu’il la fixa d’un air dédaigneux. La mécanicienne ne se priva pas de lui faire la nique, ce qui sembla provoquer chez lui un tel outrage qu’Armand s’attendit à le voir tomber en syncope ; mais il se reprit et sortit d’un pas raide, sa canne résonnant dans le couloir.
— Qui était-ce ? demanda-t-il à Martel, puisque Mathilde restait obstinément muette.
— Oh, c’est vrai que vous ne le connaissez pas… il s’agit de monsieur Hénin. Il effectue quelques travaux d’étude. Il est hélas un peu trop zélé parfois. Il semble penser que ma capacité de concentration est infinie…
— Ah, fit Joséphine. C’est le remplaçant de Mathilde, alors ?
Faraldr se rembrunit et Mathilde… Mathilde se contenta de pincer les lèvres, mais cela en disait assez long sur son opinion du sujet. Évidemment, avec tous leurs voyages pour les conférences avec Faraldr, le professeur était tout à fait en droit de trouver un nouvel assistant – mais obtenir cette place n’avait pas dû être une mince affaire pour elle et il ne pouvait croire qu’elle appréciait de la perdre aussi rapidement.
— Bien sûr que non, s’empressa alors de protester Martel. Il ne me viendrait jamais à l’esprit de remplacer mademoiselle d’Amoys, surtout par monsieur Hénin. Le pauvre est certes appliqué, mais… cela équivaudrait à vouloir remplacer une ampoule galvanique par la flamme d’une lampe à huile.
Mathilde détourna la tête, mais pas assez vite pour que la rougeur qui envahissait ses joues échappe à Armand : le compliment avait fait mouche. Aussi fut-il surpris de l’air atterré qu’elle avait en relevant les yeux.
— Professeur… je suis navrée, mais nous sommes porteurs d’une mauvaise nouvelle. La maison de ville de ma tante a été cambriolée cette nuit. J’avais laissé nos notes dans la bibliothèque et j’ai bien peur qu’elles aient été emportées.
— Un cambriolage, dites-vous ? Seigneur… il n’y a pas eu de blessé, j’espère ?
— Non, heureusement.
— Vous m’en voyez soulagé. Quels temps nous vivons ! Si même les meilleures maisons de Caen ne sont plus à l’abri des malfaiteurs…
Armand hocha la tête – mais il fixait toujours Mathilde avec attention. Elle avait parlé de notes ; pourtant elle n’avait pas repris son travail pour le professeur, même pas pour la Lettre Scandinave. Elle avait mentionné à plusieurs reprises ces derniers mois que cela lui manquait.
Alors de quoi s’agissait-il ?
— Je voulais seulement vous prévenir, poursuivit-elle. Mais ne vous inquiétez pas, je suis certaine que les forces de l’ordre retrouveront bientôt le coupable.
Sur ces mots, Joséphine émit un bruit étouffé qui était sans doute un rire sarcastique à demi-retenu. Au fil du temps, elle faisait de remarquables progrès concernant les convenances, mais certaines choses semblaient toujours à même de faire ressortir ces pires tendances. Comme la moindre mention des autorités, par exemple.
— Je n’en doute pas, je n’en doute pas, répondit Martel. Mais quant à savoir s’ils retrouveront ces notes… j’ai bien peur que nous ne devions recommencer. Je dois avoir conservé une partie de notre travail préparatoire, mais il nous faudra reprendre le témoignage de Faraldr…
Faraldr hocha la tête d’un air réticent et lui jeta un rapide coup d’œil avant de se détourner aussitôt ; Mathilde, quant à elle, évitait soigneusement de le regarder. Joséphine était penchée à la fenêtre, complètement désintéressée de la scène. Quoi que Mathilde mijote, elle n’était sans doute pas impliquée.
Armand reporta son attention sur le professeur Martel. C’était la pierre la plus faible de l’édifice ; une bonne attaque devrait suffire à faire s’écrouler tous ces faux-semblants.
— Bien sûr, dit Armand d’un air entendu, il est toujours possible que ces messieurs de la gendarmerie parviennent à tout retrouver. Je sais tous les efforts que vous avez mis dans ce travail…
— Oui. Je crois que j’ai rarement eu autant de difficultés, avec tous ces secrets à garder… mais je suis heureux de constater que vous soutenez notre engagement pour la postérité. Vous voyez, ma chère, je savais que monsieur du Thouars ne pouvait qu’approuver.
— En effet, sourit Armand sans lâcher Mathilde du regard. Qu’y aurait-il à lui reprocher ?
— Ah, si seulement ce monsieur Duclair se montrait aussi raisonnable que vous… enfin, qu’y pouvons-nous ? Le temps triomphera de toutes les oppositions, il ne faut pas en douter…
Mathilde avait à présent la teinte fort peu seyante d’une écrevisse à point ; Armand parvint à se contenir jusqu’à la fin de leur visite au professeur, mais une fois dans le couloir, il rattrapa sa cousine avant qu’elle prenne la fuite.
— Mathilde, une explication, je te prie.
Elle résista quelques secondes, avec son air le plus buté ; ce fut finalement Faraldr qui s’interposa, effleurant sa manche d’une main prudente.
— Il faut lui dire la vérité. Si tu ne le fais pas, je le ferai.
Armand haussa un sourcil, partagé entre le soulagement de trouver cette droiture chez le Normand et la constatation qu’il était bel et bien complice de ce qui se tramait dans son dos.
— Lui dire quoi ? demanda Joséphine en se penchant entre eux, l’air curieuse.
— Nous travaillions avec le professeur sur un… compte-rendu de tout ce qu’il s’est passé depuis l’arrivée de Faraldr. Sans omettre le moindre détail. Nous tentons également de reconstituer ce que le professeur Monfort a pu faire lors de son expérience qui a provoqué cette faille.
Alors seulement, Mathilde se tourna pour lui faire face, un air implorant sur le visage.
— Je sais que Duclair s’y oppose, mais il n’a pas le droit de nous tenir ainsi à l’écart de la vérité. Sans compter la postérité. Ces choses doivent être conservées et transmises.
Armand retint un soupir.
— Pourquoi me l’avoir caché ?
— Je t’en ai parlé, l’été dernier, protesta-t-elle avec une moue boudeuse. Tu as tout de suite pris le parti de Duclair.
— Que… ce projet de publication ? Enfin, Mathilde, il était évident que rendre un tel travail public serait impossible dans l’immédiat, voyons ! Il ne me semble pas avoir pris d’autre parti que celui du bon sens !
Il était sincèrement surpris : dans son souvenir, cette conversation n’avait pas la moindre importance. Un simple échange d’avis, rapide et sans polémique. Jamais il n’aurait imaginé que Mathilde pourrait lui cacher ainsi des choses. Non qu’il ait été surpris de la voir capable de dissimulation ; elle l’avait assez souvent chargé de faire le coursier de ses lectures interdites durant leur enfance pour qu’il la sache capable de duplicité lorsque cela l’avantageait. Il n’avait simplement pas pensé qu’elle se méfierait un jour de lui.
— Attendez, mais il y avait quoi dans ces notes, alors ? Des trucs importants ? questionna Joséphine, rompant le lourd silence sans vergogne.
Armand leva un sourcil ; Faraldr dut pousser une nouvelle fois Mathilde pour qu’elle se résolve à répondre.
— Toutes nos théories. Ainsi que des descriptions très détaillées.
Il secoua la tête. Faraldr au moins avait l’air grave : il devait comprendre ce que cela signifiait.
— Mathilde, est-ce que tu réalises que nous venons de démultiplier la liste des suspects potentiels pour ce vol ? Il va falloir prévenir Duclair.
Elle lui lança un regard atterré, et il se laissa fléchir. Après tout, lui non plus n’appréciait pas le moins du monde le représentant de l’Empereur.
— Si nous n’avons pas la moindre piste d’ici la fin de la semaine, je lui écrirai. Espérons que nous parviendrons à retrouver ces voleurs avant d’y être réduits…
Après cela, si elle osait encore penser qu’il n’était pas de son côté, il lui ferait manger un de ses précieux livres !
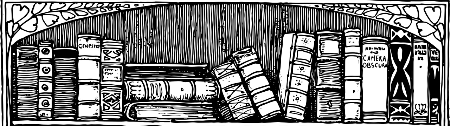
Le retour fut tendu, jusqu’à ce qu’Armand les abandonne pour se rendre à l’hôtel de police. Faraldr lui emboîta le pas lorsque Mathilde lui assura qu’elle et Joséphine pouvaient rentrer seules. Elles n’avaient que deux rues à parcourir, et Joséphine pouvait tout à fait être considérée comme une compagne acceptable pour une jeune fille de bonne famille – de l’avis de Mathilde, en tout cas. Elle n’était pas certaine que sa mère aurait été de cet avis, mais comme souvent, raisonnait que ce que sa mère ignorait ne pouvait leur faire de mal ni à l’une, ni à l’autre.
— Vous auriez pas dû le lui cacher, fit observer Joséphine avec un dernier regard en direction des deux hommes. Il va bouder toute la semaine maintenant.
— Armand ne boude pas ! s’exclama Mathilde en s’étranglant à moitié.
— Sûr, railla Joséphine. Il boudait pas la dernière fois que j’ai gagné aux cartes. Et cette fois où il a pas réussi à calmer le cheval.
— C’était un poulain à débourrer, il n’aurait jamais dû faire ce pari stupide, soupira Mathilde. Il aurait pu se blesser !
— Eh, c’est pas moi qui ai commencé à parier, se défendit Joséphine. Et puis c’est pas ma faute s’il s’ennuie tout le temps. S’il faisait quelque chose de ses journées, au moins…
Mathilde retint un autre soupir. Joséphine n’avait pas tort : lorsqu’ils rentraient en France entre deux conférences européennes, Armand était toujours celui qui s’ennuyait le plus. Joséphine avait à faire, entre l’entretien de Sleipnir et les menues besognes pour lesquels sa tante avait souvent besoin de ses services ; Faraldr trouvait facilement à s’occuper, que ce soit en travaillant son français ou en aidant dans la maisonnée – récemment, il avait même commencé à lui demander de lui apprendre à lire. Et elle-même, entre les leçons à Faraldr, les conférences et articles à préparer et ses séances avec le professeur Martel, voyait son temps se réduire comme peau de chagrin.
Armand se plaisait à voyager et s’employait systématiquement à rassembler quantité d’informations qui servaient apparemment aux différentes ambassades en Europe ; mais il avait perdu tout statut officiel et toute occupation depuis qu’il avait été libéré de ses fonctions par l’armée aéroportée – et cela lui coûtait plus qu’il ne voulait bien l’admettre.
Elle avait décidément eu tort de lui cacher ce qu’elle faisait avec le professeur, mais il était trop tard à présent. Elle ne pourrait que se montrer particulièrement gentille jusqu’à ce qu’il lui pardonne.
Elles trouvèrent la bibliothèque retournée à son état de rangement habituel : les livres parfaitement alignés qu’Anne-Marie finissait de classer par domaine et auteur, et le bureau submergé par les papiers de tante Henriette, qui jurait ses grands dieux qu’elle avait sa propre forme d’ordre et que tout autre système ne faisait que lui compliquer la tâche.
— Ah, Mathilde, justement. Tiens, je crois que ceci est à toi.
Mathilde alla chercher la liasse que lui tendait Anne-Marie, le cœur battant à tout rompre, et manqua pousser un cri fort déplacé lorsqu’elle réalisa qu’il s’agissait d’une partie des notes de son travail avec le professeur Martel.
— Où était-ce ?
— Elles étaient coincées sous plusieurs livres. Je suis désolée, elles sont un peu froissées…
— Cela ne fait rien. Merci beaucoup.
Mathilde continua de feuilleter rapidement les pages tandis que Joséphine venait se mettre sur la pointe des pieds derrière elle pour lire par-dessus son épaule.
— C’est le truc du professeur ? demanda la mécanicienne.
— Oui… une partie, en tout cas. Il manque tout le début, le témoignage de Faraldr et les précisions sur son époque, mais on dirait bien que tout ce qui concerne nos théories sur l’expérience est là. Oh, quel soulagement !
— C’est Armand qui va être content, tiens.
— Cela devrait le convaincre de ne pas prévenir monsieur Duclair… mais les feuillets disparus… pensez-vous que le voleur en avait vraiment après ce texte ?
Elles échangèrent un regard, puis Joséphine haussa les épaules.
— On le saura si on le retrouve.
Tante Henriette les fixait d’un air soupçonneux, aussi Mathilde entraîna-t-elle rapidement Joséphine hors de la pièce.
— J’aimerais autant que le moins de monde possible soit au courant…
— Si vous voulez cacher ça à la dragonne, bon courage, ricana Joséphine.
Mathilde retint un soupir. Le surnom trouvé par Armand s’était répandu dans toute la maisonnée. Elle était presque certaine d’avoir entendu même André l’utiliser, alors que le majordome était toujours si respectueux des convenances.
Il fallait avouer qu’il allait plutôt bien à sa tante.
— Joséphine, il est essentiel que…
Le bruit de la porte l’interrompit, suivi d’une commotion dans l’entrée.
— Ah, bonjour André. Qu’a encore fait ma chère sœur pour se retrouver avec un gendarme devant la maison ?
Mathilde se sentit soudain mal.
— Oh non.
— Ah, Bon Dieu, jura Joséphine. Vos parents sont déjà là ?
— Seigneur…
— Ah ! Ma fille ! s’exclama son père en apparaissant dans l’escalier. Content de te voir enfin. Tu vas pouvoir nous expliquer ce qu’il se passe ici. As-tu déniché un autre Viking ?
— Oh, Charles, le morigéna la mère de Mathilde en montant à son tour les marches. Bonjour, mademoiselle Joséphine. C’est un plaisir.
Mathilde jeta un regard rapide à Joséphine, qui était comme toujours vêtue d’un pantalon – celui-ci, au moins, n’arborait pas la moindre tache de graisse.
Elle n’était pas certaine que cela suffirait à le faire accepter comme une tenue convenable à sa mère.
— Papa… Maman… Soyez les bienvenus à Caen, réussit-elle à souffler d’une voix faible.
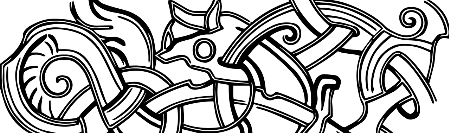
Faraldr avait appris bien des choses depuis son arrivée au XIXe siècle ; mais la plus importante était sans doute que les salons de ces maisons débordantes de richesses constituaient de véritables champs de bataille, dans lesquels un mot de travers pouvait avoir des conséquences terribles. Que ses adversaires soient les parents de Mathilde ne changeait rien à cela.
Il les avait croisés à plusieurs reprises, mais à cause de leurs voyages, cela n’avait été que très brièvement ; il gardait cependant de ces occasions l’impression de ne pas avoir été à la hauteur et il comptait bien y remédier. Lorsque André leur apprit, à Armand et lui, que le chef de famille était arrivé, il inspira donc profondément et se prépara à se comporter en parfait hôte.
Le père de Mathilde, qui portait une fine moustache et un bouc soigneusement peignés, les accueillit avec un sourire avenant.
— Ah, Armand. Il paraît que tu t’es dégotté une canne-épée ? Il faudra que tu me montres cela. Et Faraldr Helgusson… enchanté de vous revoir, monsieur, fit-il en tendant la main.
Faraldr connaissait parfaitement la coutume de la poignée de main, à présent. Cependant, il ne l’appréciait guère. La majorité des hommes lui tendaient, sans réfléchir, la main droite. C’était toujours gênant, car il n’avait pas assez de dextérité dans sa prothèse pour accomplir le geste rituel. Il se trouvait alors obligé de se dérober en leur tendant plutôt sa propre main gauche. La seule alternative était de les laisser serrer sa main de métal inerte, ce qui les mettait mal à l’aise.
Pas cette fois, cependant : le père de Mathilde lui présenta sa main gauche sans même marquer de temps d’arrêt. Il avait tendu la droite à Armand : il n’était donc pas simplement gaucher, mais avait pris en considération son bras mécanique. Un homme attentif aux moindres détails.
La mère de Mathilde était plus petite que sa fille, le teint pâle et délicat, une véritable beauté aux gestes gracieux. Lorsqu’elle arriva devant Faraldr, elle lui tendit également la main gauche ; et quand il releva la tête après avoir à peine effleuré le dos de sa main de bout des lèvres, comme Armand le lui avait appris, elle souriait comme s’il venait d’accomplir une merveille.
— Je suis heureuse de vous revoir, Faraldr Helgusson, lui dit-elle dans un islandais impeccable. Mais pardonnez-moi, je vous prie, poursuivit-elle dans un français plus lent ; j’ai bien peur de ne pas avoir le talent de ma fille pour votre langue.
— Vous la parlez très bien, s’empressa-t-il de lui assurer. J’espère pouvoir parler aussi bien français, bientôt.
Elle eut un nouveau sourire, puis retourna s’asseoir, les invitant à la suivre d’un geste.
Dès qu’ils eurent pris place, une servante entra, apportant un plateau de café et de biscuits. Faraldr considéra les parents de Mathilde, qui discutaient avec Armand et leur fille des festivités prévues au Bec pour les prochains jours. La scène était empreinte de tranquillité, parfois rompue par le rire jovial de monsieur d’Amoys. Cependant, Faraldr ne parvenait pas à se détendre. Il avait fait suffisamment de progrès en français pour comprendre à peu près tout ce qu’on lui disait, sauf si son interlocuteur se plongeait dans des formules trop complexes – ce qui lui était arrivé à plusieurs reprises durant leurs voyages de l’an passé. Les savants de toute l’Europe avaient en commun de se lancer fréquemment dans des débats qui le laissaient perdu. Sa grammaire n’était pas encore parfaite, mais il parvenait à s’exprimer, et c’était l’essentiel. Le reste se ferait petit à petit.
Il pouvait donc suivre ce qui se disait sans problème – techniquement, tout du moins. Car s’il y avait bien une chose qu’il avait apprise durant ces mois de galas et de conférences, c’était que la conversation, depuis son époque, était un art qui avait changé du tout au tout. Ou peut-être était-ce simplement qu’il n’avait pas suffisamment de… Mathilde avait trouvé une bonne manière de l’expliquer : suffisamment de références culturelles modernes. Il ne comprenait pas toutes les allusions rapides, faites en passant, mais qui conféraient à la discussion davantage de profondeur ; il ne reconnaissait pas immédiatement les opinions de son interlocuteur en fonction de ce qu’il exprimait sur un sujet. La politique était bien loin de lui réussir, et s’il avait fait quelques percées dans le domaine de l’humour, il savait qu’il avait encore du chemin à parcourir.
Heureusement, la conversation tournait pour l’instant autour de l’échange de nouvelles. Rien de trop difficile, même si la réplique de sa mère sur le mariage d’une de leurs connaissances n’expliquait en rien à ses yeux la façon dont Mathilde venait de se rembrunir.
— Comment avez-vous trouvé Vienne, monsieur Helgusson ? lui demanda-t-elle ensuite avec un sourire charmant, faisant allusion à la conférence du mois passé.
— C’est une jolie ville, s’empressa-t-il de répondre. Mais je ne comprenais pas beaucoup la langue.
— Je pensais pourtant que les austro-hongrois avaient à cœur de parler français…
— Tout se perd, ma chère, intervint le père de Mathilde. La France n’a plus le rayonnement qu’elle avait jadis, chaque nation est occupée de son propre prestige…
— Oh, avec l’Exposition universelle de l’an prochain, je suis certaine que cela va changer, sourit madame d’Amoys. Cela me fait penser, Mathilde, j’ose espérer que vous viendrez à Paris pour l’Exposition ?
— Oui, maman.
Faraldr avala une gorgée de café. Le visage de Mathilde avait quelque chose de crispé. Pourtant, ils avaient déjà discuté de cette… exposition. D’après ce qu’il avait compris, il s’agissait d’une sorte de grande foire où les différents peuples pouvaient se vanter de leurs plus remarquables accomplissements – même si, lorsqu’il l’avait exprimé ainsi, Armand avait éclaté de rire.
En tout cas, il ne voyait pas ce qui mettait Mathilde mal à l’aise. Il regarda son sourire se crisper encore davantage tandis que sa mère et Anne-Marie se plongeaient dans des considérations sur la garde-robe qu’il leur faudrait se constituer pour l’occasion, et finit par se pencher vers elle. Il voulait simplement lui prendre la main pour l’assurer de son soutien, même s’il n’était pas sûr de comprendre ce qui la gênait ; mais dès qu’il l’effleura, elle sursauta violemment et se rabattit en arrière, les joues rougies. Puis elle rajusta sa tasse dans sa soucoupe et attrapa un biscuit avec une nonchalance peu convaincante.
Lorsque Faraldr releva la tête, il réalisa que les deux parents de Mathilde le fixaient, son père avec un demi-sourire sous sa moustache, sa mère d’un air plus perçant, comme si elle cherchait à lui ouvrir le crâne pour en extraire la moindre de ses pensées. Il esquissa discrètement un geste pour conjurer le mauvais sort. Heureusement, madame d’Amoys ne pouvait pas savoir de quoi il s’agissait ; elle ne risquait pas de prendre injure qu’il la considère comme une potentielle sorcière.
À ses côtés, Joséphine émit un bruit qui ressemblait suspicieusement à un ricanement étouffé et Faraldr lui lança un regard peu amène. Puis le père de Mathilde choisit ce moment pour lui demander ce qu’il pensait des avancées technologiques de leur temps – un sujet simple et dont il avait l’habitude de devoir parler. Il se plongea dans la conversation avec soulagement.
Ce n’est qu’un peu plus tard qu’il se souvint du cours d’Armand sur les bonnes manières – et sur le fait que les hommes et les femmes, à moins de faire partie de la même famille ou d’être fiancés, ne se touchaient qu’en de rarissimes occasions.
Avec un peu de chance, les parents de Mathilde avaient pris cela pour une excentricité ou une maladresse d’étranger. Mais il réalisait soudain qu’il allait, dans les prochains jours, devoir faire bien plus attention à ses gestes qu’à bord de Sleipnir. Il comprenait mieux la terreur qui se lisait sur le visage de Mathilde lorsqu’elle parlait de l’étiquette.

Joséphine sortit avec soulagement du salon lorsqu’on se retira pour se préparer avant le dîner. Heureusement, tout le monde était habitué à ce qu’elle prenne ses soupers dans l’office, avec Liberté. Pour ce qui était des autres repas, tout dépendait de s’ils avaient une conférence de prévue et des plans à faire. Elle ne pensait pas que Mathilde lui en voudrait si elle se cantonnait aux quartiers des domestiques durant les jours à venir.
— Joséphine ! Tu as vu monsieur et madame d’Amoys ? Oh, ne me dis pas que tu étais habillée comme ça…
Liberté, qui venait de surgir de la bibliothèque où elle aidait madame Mernet à finir son rangement, croisa les bras comme une matrone. Joséphine haussa les épaules en baissant les yeux vers sa tenue.
— Quoi ? Il est très bien, ce pantalon. C’est ma tenue de ville. Regarde, y a pas une tache.
— Joséphine…
— Oh, ça va. De toute façon, ils me verront plus si je peux l’éviter, crois-moi. Tu as déjà croisé la mère de Mathilde ?
— Elle est toujours très gentille.
— Oui. Et terrifiante.
Liberté éclata de son petit rire chantant.
— Quoi ? s’indigna Joséphine.
— Rien. Je ne t’ai jamais entendu dire que mademoiselle d’Amoys était terrifiante, mais madame d’Amoys, si ?
— Tu veux dire la dragonne ? Bien sûr qu’elle est terrifiante.
Mais au moins, elle était toujours franche. Et elle n’avait jamais attendu de Joséphine qu’elle sache se comporter comme il faut. La mère de Mathilde, par contre, avait l’air d’être à l’origine de tous les manuels d’étiquette qu’Armand s’était amusé à dénicher pour apprendre les manières de leur époque à Faraldr. Joséphine se targuait de connaître ses forces et ses faiblesses. Et la politesse, ça ne faisait pas exactement partie de ses forces.
— Joséphine !
Armand surgit dans le couloir, suivi de Mathilde et de Faraldr. Apparemment, tout le monde n’avait pas décidé d’aller se rafraîchir avant le repas.
— Nous avons des nouvelles de la gendarmerie, lui apprit l’ex-militaire. Mademoiselle Ménincourt a vu un homme s’éloigner de la maison quand la dragonne et mademoiselle de Haurecourt sont rentrées. Il les aura entendues arriver.
Joséphine retint un ricanement. Évidemment, le seul témoin était la pire commère du voisinage.
— Ils ont aussi étudié les empreintes de pas. Malheureusement, en-dehors du fait qu’il doit s’agir d’un homme assez grand, ils n’ont pas pu en obtenir grand-chose de plus.
— Très utile.
— En revanche, ils sont persuadés que l’homme est tombé en sautant de la fenêtre. Et le témoignage de cette chère mademoiselle Ménincourt corroborerait cette hypothèse : elle affirme avoir vu l’intrus partir en boitant.
— Donc on cherche un type assez grand et qui boite ?
— Pas sûr, tempéra Faraldr.
— Tu as raison, approuva Mathilde. Il ne s’est pas forcément fait assez mal pour boiter plus longtemps que quelques heures.
— Ben ça nous aide bien, tout ça, soupira Joséphine. Franchement, ces types de la police…
— De la gendarmerie. Et si vous pouviez éviter de les traiter encore d’incapables… Je crois que nous avons tous compris votre opinion sur le sujet, railla Armand.
— Sûr que je peux arrêter. Une seule condition : c’est moi le commandant de Sleipnir durant le prochain voyage.
— Quoi ? Mais… c’est hors de question. Et je ne vois pas… Je ne vois pas le rapport, enfin, s’indigna aussitôt Armand, comme elle l’avait prévu.
— Dommage. Fallait tenter, lâcha Joséphine avant de suivre Liberté dans le couloir des domestiques. Allez, à tout à l’heure, et faites pas de bêtises à table !
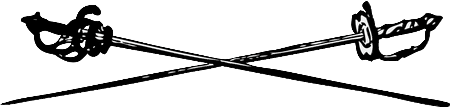
— Charles, tu n’es qu’un serpent de la pire espèce !
— Merci, Henriette.
— Donc, vous êtes certains qu’il ne vous manque rien ? répéta Armand pour confirmer.
— Eh bien oui, étant donné que mon cher frère avait pris sur lui d’emporter toutes les lettres du duc de Montrose. C’était la seule chose qui manquait à la liste établie par madame Mernet.
— Voyons, Henriette, ne m’en veux pas. C’est notre ministre des postes et télégraphes qui m’a demandé cette correspondance. Tu sais que la politique mise en place au Royaume-Uni présente des points d’intérêts…
— Sommes-nous donc au service de l’Empire, Charles ?
— Eh bien…
— J’ose espérer que non !
— Il est tout de même de notre devoir de soutenir notre patrie, il me semble.
— Ah ! La patrie !
Armand serait volontiers resté pour apporter son appui à Charles d’Amoys, qui aurait besoin de toute l’aide possible s’il voulait tenir son argumentation face au rouleau compresseur qu’était la dragonne ; mais Mathilde choisit ce moment pour entrouvrir la porte de la bibliothèque et lui faire signe.
— Qu’y a-t-il ?
— Télégramme. Pour toi.
Il tendit aussitôt la main, mais Mathilde secoua la tête avec une moue boudeuse.
— André a refusé de me le donner. Ah, le voilà.
Le majordome finissait de gravir les escaliers et s’approcha de son pas tranquille, muni de son plateau en argent.
— Monsieur du Thouars. Télégramme pour vous.
— Merci, André.
— Monsieur. Mademoiselle Mathilde…
Mathilde eut au moins la bonne grâce d’attendre que le pauvre homme ait tourné les talons pour saisir l’enveloppe des mains d’Armand.
— De qui est-ce ?
— Enfin, Mathilde, rends-moi mon courrier tout de suite, je te prie !
— Oh, très bien, mais ouvre-le ! Il vient de Paris. Est-ce que c’est Duclair ?
— Tu prends de très mauvaises habitudes. Voler le courrier, non mais vraiment. Est-ce Joséphine qui déteint sur toi ? Ou Faraldr, peut-être ?
— Tu as bien vu comment Faraldr a réagi au vol de la bibliothèque. Quant à Joséphine, tu es injuste avec elle. Pourquoi volerait-elle quoi que ce soit ? Parce qu’elle a des origines plus modestes ?
— Non, tu as raison. Joséphine ne volerait jamais mon courrier, elle. J’imagine que nous ne pouvons pas blâmer cette tare sur qui que ce soit d’autre que toi-même, en ce cas…
— Armand, ne m’oblige pas à commettre quelque chose que tu regretteras. Ouvre ce télégramme !
— Ah, je crois que j’ai trouvé l’os. Tu passes bien trop de temps avec ta tan…
Armand s’interrompit en voyant le message du télégramme. Il s’agissait bien de Duclair, qui leur écrivait pour leur apprendre l’arrivée d’un aérodyne américain à Nantes quelques jours plus tôt. Il les mettait en garde : il était fort possible que ces messieurs d’outre-Atlantique soient intéressés par Faraldr. Les États-Unis, déterminés à faire oublier leur affaiblissement dû à la guerre civile récemment achevée, s’étaient jetés dans la course à la faille temporelle avec énergie.
— Où sont Faraldr et Joséphine ?
Ils trouvèrent Joséphine dans l’appentis qui abritait l’une des deux voitures de la famille. La mécanicienne effectuait une révision, bien emmitouflée dans un des épais pull-overs rapportés d’Islande. Faraldr, lui, était dans la cour, occupé à discuter avec une des souillons de cuisine qui plumait un volatile. Naturellement, le Viking était en manches de chemise malgré le froid. Armand resserra sa veste avec un frisson. La Normandie pouvait certes se vanter d’un temps clément en ce mois de décembre, mais la neige n’était pas loin.
Heureusement, Mathilde eut le bon sens de les rassembler tous dans l’appentis plutôt que dehors. Armand leur expliqua rapidement la situation, et fit de son mieux pour mettre de côté la basse satisfaction qu’il ressentit en voyant la culpabilité sur le visage de Mathilde.
— Tu crois que le voleur était un Américain ? demanda Faraldr.
— Je l’ignore, mais ce n’est pas impossible. S’ils cherchent des informations, il n’y a que quelques lieux où ils pourraient espérer les trouver, avec la façon dont Duclair a réussi à faire disparaître Monfort de la circulation : chez le professeur Martel, ou ici.
— Ou au Bec, releva Joséphine.
— En effet. Mais il ne serait pas difficile, en se renseignant un peu, d’apprendre que Mathilde d’Amoys et le célèbre Faraldr Helgusson, lorsqu’ils sont en Normandie, résident habituellement à Caen.
— Alors qu’est-ce qu’on fait ?
— Le plus raisonnable serait de prévenir monsieur Duclair du vol…
Mathilde émit un bruit qui ressemblait à un gémissement étouffé, et Armand prit pitié de sa cousine.
— … mais nous pourrions peut-être commencer par mener l’enquête de notre côté.
Après tout, Duclair avait montré très clairement, ces derniers mois, qu’il ne comptait pas les tenir au courant de quoi que ce soit à moins d’y être obligé par les circonstances. Le moins qu’ils pouvaient faire était de lui rendre la politesse.
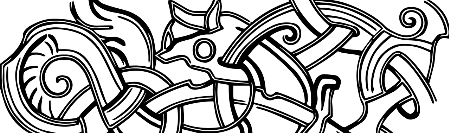
Faraldr s’était habitué aux hôtels ces derniers mois. Celui où ils se présentèrent à Caen était certes moins luxueux que ceux des grandes villes européennes où ils s’étaient rendus pour les conférences de Mathilde, mais il savait à quoi s’attendre : les différents serviteurs qui s’occupaient de gérer l’établissement, les diverses petites salles au rez-de-chaussée où l’on pouvait venir manger, lire des journaux et discuter, la façon dont les voyageurs ne prêtaient pas la moindre attention à ce qui les entourait, contrairement au régisseur derrière le comptoir, qui voyait tout.
Il remarqua qu’un jeune garçon en uniforme partait en courant dans les étages juste après leur arrivée et se pencha vers Mathilde et Armand.
— Je crois qu’ils nous guettaient.
— Je pense plutôt que le concierge du Normandie enchantée est l’un des meilleurs de France lorsqu’il s’agit de se renseigner sur ce que peuvent vouloir ses clients, le reprit Armand en faisant un signe de tête au concierge. Mais le résultat est le même. Allons dans l’orangerie. Ça ne devrait pas être long.
Il avait raison : quelques minutes plus tard, juste le temps pour Mathilde de trouver un livre oublié dans un fauteuil et pour Joséphine de soupirer trois fois d’ennui, deux hommes firent leur apparition, précédés par un laquais.
— Veuillez m’excuser, ces messieurs souhaiteraient vous être présentés.
S’ensuivit le rituel des présentations, au cours duquel Faraldr apprit que le premier Américain se nommait Mister Quincy et que le second était son assistant, un homme plus jeune appelé Jack Lowe. Les deux l’observèrent avec cet air fasciné auquel il s’était habitué depuis son arrivée à cette époque, avant que le plus âgé parvienne à se reprendre avec un effort visible.
— C’est un honneur de vous rencontrer, mister Helgusson. Nous avons beaucoup entendu parler de vous, outre-Atlantique. Je suis chargé par la American Society of Time Travel de vous inviter à New York. Certains de nos membres peuvent faire remonter leur arbre généalogique jusqu’à des temps reculés, dans certaines parties de la Scandinavie. Peut-être avez-vous connu leurs ancêtres !
Faraldr se contenta de sourire sans répondre et sentit sa prothèse bouger. Il crispait toujours inconsciemment la main quand quelque chose le dérangeait, et il n’appréciait pas vraiment de se voir rappeler sa situation par de parfaits inconnus. En discuter avec Mathilde et le professeur Martel était déjà suffisamment douloureux.
Comme s’il l’avait réalisé – ce qui était tout à fait possible, car il était attentif –, Armand détourna la conversation. Faraldr s’appuya sur le dossier de son fauteuil et observa en silence les deux Américains pour tenter de repérer des signes de mensonge ou d’inconfort sur leur visage. L’assistant, Jack, semblait particulièrement prometteur : il n’avait pas l’air de savoir bien contrôler ses expressions. La manière dont son regard allait de Joséphine au reste d’entre eux voulait sans doute dire quelque chose, mais Faraldr ne perdit pas de temps à essayer de comprendre quoi. Il se contenterait de livrer ses observations une fois qu’ils seraient partis.
Il fut satisfait de constater qu’il arrivait à suivre la conversation, même si l’accent de Quincy lui donnait du fil à retordre, et même si ladite conversation consistait principalement en politesses que Mathilde, Armand et l’Américain se renvoyaient. À côté de lui, Joséphine avait sorti un tournevis d’une poche et le faisait tournoyer dans sa main sans paraître prêter attention à ce qu’il se passait. Il surprit le regard qu’elle lançait à Quincy par en-dessous : elle aurait elle aussi des choses à dire après l’entretien.
— Ma famille organise un bal le 23 décembre. Vous nous feriez un grand honneur en vous joignant à nous, proposait Mathilde.
— Ce serait avec joie, mademoiselle d’Amoys. Nous pouvons bien sûr rester à Caen jusque là.
— Oh, ce sera au manoir du Bec… Il se situe à quelque distance de Caen, malheureusement. Peut-être nous ferez-vous le plaisir d’accepter une invitation à être des nôtres durant quelques jours ?
— Well… J’en serais ravi, mademoiselle. Merci beaucoup.
Les politesses reprirent de plus belle, puis Armand renseigna Quincy sur des questions d’ordre pratique. C’est alors seulement que Faraldr réalisa qu’ils devaient quitter Caen pour le Bec le lendemain. Rien d’étonnant à cela : si les d’Amoys devaient organiser une célébration, il leur faudrait du temps. Il avait été heureux d’apprendre qu’il y avait toujours une fête de la mi-hiver. Tellement de choses avaient changé depuis son époque, un peu de familiarité lui faisait du bien.
Lorsqu’ils sortirent enfin, Faraldr n’était pas certain d’être beaucoup plus avancé.
— Quincy n’avait pas l’air de mentir ou de cacher quoi que ce soit, mais le jeune homme était nerveux.
— Peut-être était-il intimidé par toi, fit observer Armand.
— Possible. Ou par Joséphine. Il la regardait souvent.
— M’étonnerait, lança la mécanicienne. C’est sans doute plutôt parce que je suis noire. S’il vient du Sud… même du Nord, en fait.
— Oh, fit Mathilde. Vous croyez ?
— Sûr.
Faraldr essayait de comprendre, sans grand succès, lorsque Mathilde se tourna vers lui.
— Ah… Comment expliquer… Les États-Unis sortent à peine d’une guerre à propos de l’abolition de l’esclavage, je t’en ai déjà parlé ?
— Peut-être…
Parfois, il était difficile de garder en tête tout ce qu’il avait appris ces derniers mois. Surtout que Mathilde était, comme le disait Joséphine, un véritable puits de savoir, qu’elle avait à cœur de partager le plus possible. Faraldr n’était pas certain de pouvoir supporter de recevoir autant de connaissances. Il fallait être un dieu pour y parvenir, et même si sa mère l’avait confié au bon vouloir d’Oðinn, il n’avait pas envie de perdre un œil en plus de son bras.
— Les esclaves étaient presque toujours des personnes noires, ajouta Mathilde en jetant un regard nerveux en direction de Joséphine.
— Pourquoi ?
Un silence suivit sa question, et Faraldr soupira. Encore une fois, il avait mis le doigt sur un sujet épineux. Ça arrivait souvent : il se retrouvait face à une notion qu’il croyait connaître, pour découvrir qu’elle avait bien changé. Il y avait eu de nombreux esclaves, de son temps. Mais il ne pensait pas avoir jamais rencontré un marchand qui les vende en fonction de la couleur de leur peau. L’idée même paraissait ridicule.
À la façon dont Mathilde inspirait profondément, il réalisa qu’il en avait probablement pour plusieurs heures d’explication.
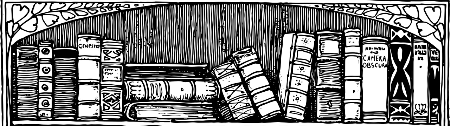
— Je sais bien que la duchesse de Castiglione Colonna conduit une automobile. Ça ne signifie pas pour autant qu’il s’agit d’une occupation respectable. Vraiment, cela me semble aisé à comprendre.
— Est-ce de ma faute si Mathilde est sans doute la meilleure conductrice de toute la Normandie ? Au moins, cela lui a été utile, en Islande.
Mathilde s’efforça de se faire plus petite encore, mais c’était difficile alors qu’elle était justement en train de conduire la voiture dans laquelle sa mère, sa tante et mademoiselle de Haurecourt avaient pris place. Anne-Marie avait pourtant essayé de maintenir la paix durant le trajet ; mais sa mère et sa tante n’étaient pas faites pour s’entendre.
Sa tante n’était de toute manière pas faite pour s’entendre avec grand-monde, et sa mère ne disposait pas de toute une vie d’habitudes et d’un caractère patient, contrairement à son père. Les étincelles étaient immanquables.
— Que voulez-vous dire, Henriette ? Mathilde ?
— Eh bien…
— Je parle bien sûr de la façon dont elle a réussi à échapper au corsaire à Selfoss !
— Mathilde ?
La voix de sa mère avait pris un ton qui ne présageait rien de bon. Mathilde maudit intérieurement sa tante, même si elle ne se serait pas risquée à le faire à haute voix. Elle avait opéré quelques coupes soigneuses dans le récit de leurs aventures islandaises, et minimisé son implication autant que possible. Son passage à bord d’un langskip volant durant la course avait déjà paru inquiéter suffisamment ses parents.
— Nous avons dû emprunter l’auto de madame Göring pour quitter Selfoss, résuma-t-elle en gardant les yeux sur la route.
Derrière elle, la voiture conduite par Joséphine semblait bien plus paisible. Mathilde aurait donné une bonne partie de sa collection de sagas islandaises pour s’y trouver en cet instant, plutôt que de sentir le regard de sa mère qui menaçait d’embraser son chignon. Elle aurait même volontiers supporté les disputes de Joséphine et d’Armand. Ce n’était pas si terrible, surtout avec la présence de Faraldr. Il avait un humour discret, mais indéniable qui ressortait dans ce genre d’occasion, et avait déjà permis d’apaiser les tensions à plusieurs reprises durant leurs voyages.
Enfin, le manoir du Bec se détacha sur l’horizon et Mathilde poussa un soupir de soulagement – dans le silence le plus complet, bien sûr. La conversation était passée sur les préparatifs du bal, et elle ne voulait surtout pas attirer à nouveau l’attention de sa mère.
Julie, Pierre et Jean étaient descendus les attendre et les aidèrent à sortir les quelques malles des voitures. Le reste de leurs affaires arriveraient le surlendemain, en même temps que le père de Mathilde et que ces messieurs les Américains.
Mathilde profita de la distraction générale pour laisser sa mère, sa tante et Anne-Marie prendre de l’avance, et se rapprocha de Faraldr. Il était demeuré en retrait et contemplait les arbres dénudés qui se dressaient dans le parc du manoir.
— Votre trajet s’est bien passé ? demanda-t-elle en norrois.
Faraldr se tourna vers elle avec un sourire ravi, et elle se dit une fois de plus qu’il fallait qu’elle lui parle plus souvent ainsi. C’était lui qui insistait pour parler français le plus souvent possible, afin de parfaire sa maîtrise déjà impressionnante, mais sa propre langue lui manquait, elle le voyait bien.
Ce n’était même pas exactement sa langue ; ils parlaient un mélange d’islandais et de norrois classique mâtiné de tournures dialectales. Mais c’était ce qu’elle pouvait lui offrir de plus approchant.
— Très bien. Liberté m’a appris une nouvelle chanson, et je lui ai aussi appris une chanson norroise.
— Oh, pourras-tu me la chanter ?
— Bien sûr. Pour Jòl, si tu veux. C’est traditionnel.
— Parfait.
— Mathilde… Ce bal… Est-ce une fête pour l’hiver ? Ou une fête chrétienne ?
— Oh… Ce n’est pas exactement une fête chrétienne, juste un bal pour la saison. La véritable fête a lieu dans la nuit du 24 décembre, pour la naissance du Christ. Il y a de nombreuses festivités durant cette période. Je suis sûre que certaines sont très anciennes. Tu célébrais le solstice, c’est ça ?
— Oui. La fête dure plusieurs jours. Nous invoquons les dieux pour leur demander de bénir le soleil, pour ramener le printemps et des récoltes prospères. Nous renouvelons aussi nos serments et nous formons des alliances. Les communautés et les unions liées à Jól sont plus résistantes. Elles sont sacrées.
— Je crois que notre fête de Noël contient beaucoup de survivances de Jòl. Après tout, ton peuple s’est installé en Normandie.
Faraldr hocha la tête, mais son regard paraissait lointain. Mathilde se retint de le questionner. La curiosité la dévorait, mais elle avait appris que lorsque Faraldr était ainsi, c’était un signe de mélancolie. Les siens lui manquaient. Ce devait être pire encore à l’approche d’une telle fête.
— En tout cas, j’espère que tu es prêt : toutes les demoiselles des environs vont se battre pour danser avec toi durant ce bal.
Il tourna vers elle un regard surpris, avant de sourire.
— Même toi ?
— Oh, je ne sais pas si j’en suis une. D’après maman, une vraie demoiselle ne conduit pas d’automobile.
— Ah. Tu ne lui as pas encore raconté tout. Pour l’Islande.
— Grands dieux, non. Mais tante Henriette a vendu la mèche, pour notre fuite de Selfoss en tout cas. Je n’ai plus qu’à espérer que le bal l’occupe assez pour qu’elle n’y pense plus…
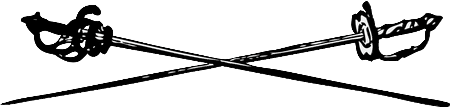
Armand, en tant qu’habitué du Bec, avait déjà eu l’occasion de voir Emma d’Amoys à l’œuvre à de nombreuses reprises lorsqu’il s’agissait d’organiser un bal ; pourtant, cela restait toujours aussi impressionnant. Toute la maisonnée se transformait littéralement pour orbiter autour du salon vert, qui était le quartier général de ces opérations. Les ordres fusaient, suivis plus rapidement encore qu’à bord du Clovis. Les victuailles étaient engrangées en quantités dignes d’un palais, les cuisines tournaient à plein régime, toute la domesticité était sur le pont pour cirer les parquets, laver tout ce qui devait l’être et garnir les lustres et chandeliers. Car le bal serait à l’ancienne, sans la moindre lumière galvanique à l’horizon – sauf dans les communs, bien sûr, où Julie et son armée avaient assez de pain sur la planche sans se soucier des dernières lubies à la mode.
Armand salua tante Emma, qui se trouvait postée en bas de l’escalier principal, occupée à étouffer dans l’œuf tout problème et à affecter chacun à son rôle. Il restait encore deux jours avant le bal, mais il y avait apparemment beaucoup à faire. La présence de Faraldr en était la cause : le prestige rejaillissant sur les d’Amoys les obligeait à organiser des festivités dignes de leur invité d’honneur. Elle lui accorda un rapide signe de tête avant de se pencher sur un minuscule carnet relié à la châtelaine bien fournie attachée à sa ceinture, et Armand retint le réflexe qui lui venait d’esquisser un salut militaire. Oncle Charles avait coutume de dire que Napoléon III ferait bien de s’inspirer de l’éducation des dames de bonne famille s’il voulait étendre son Empire ; parfois, Armand se demandait si ce trait d’humour ne cachait pas quelque vérité.
Il trouva monsieur Quincy attablé dans la petite salle à manger du matin, en pleine conversation avec Faraldr et Mathilde.
— … certaines sagas, disait Mathilde avec l’air d’être sur le sujet depuis un certain temps déjà, indiquent d’ailleurs qu’il est fort possible que des contemporains de Faraldr aient pu traverser l’Atlantique, et…
— … Et en tout cas, je suis sûr que notre cher Viking est tout à fait disposé à découvrir le Nouveau Monde à son tour, n’est-ce pas Faraldr ? intervint Armand en s’avançant dans la pièce. Bonjour, mister Quincy. Mathilde, Faraldr…
L’Américain le salua avec un regard où se lisait du soulagement : côtoyer Mathilde de bon matin était une activité qui ne se pratiquait qu’avec une certaine expérience. Armand accepta avec un sourire le café au lait que lui tendait sa cousine et s’attabla à côté de Faraldr. Il nota avec surprise que le Normand portait déjà sa prothèse : habituellement, il ne la mettait pas dès le réveil. Était-il gêné par la présence de Quincy ?
— Je disais à mademoiselle d’Amoys que cette demeure est magnifique, fit alors ce dernier. Et la campagne normande… Delightful. Un régal.
Armand leva le nez vers la fenêtre, dubitatif. Entre les rideaux jaunes, le ciel était d’un gris sombre uniforme qui ne présageait rien de bon. Loin de lui l’idée de dénigrer la région, mais il y avait des saisons plus agréables pour découvrir la Normandie. La neige était de la partie : ils avaient dû affronter des congères lors de leur arrivée.
— À ce propos, poursuivit l’Américain sans s’arrêter au silence, monsieur d’Amoys m’a dit que vous pourriez peut-être me faire visiter les environs ? Je suis très curieux de ces automobiles galvaniques que vous avez, nos modèles sont un peu différents aux États-Unis…
— Eh bien… Qu’en penses-tu, Mathilde ? Une sortie sera-t-elle possible aujourd’hui ?
Quincy parut surpris qu’il s’en remette à Mathilde, mais Armand n’était ni assez idiot, ni assez suffisant pour ne pas admettre qu’elle était bien plus à même de répondre à cette question. Sans doute serait-il obligé de conduire ou de laisser le volant à Joséphine, en revanche : tante Emma refuserait catégoriquement de voir sa fille conduire un invité.
Même si en convaincre Mathilde serait difficile.
— Cela devrait être possible, même s’il faudra vous méfier du temps…
— Nous ? Tu ne seras pas des nôtres ?
— Oh, non, je ne crois pas. Maman aura besoin de mon aide, et je dois travailler sur le rapport pour le professeur Martel. J’ai encore en tête certaines des parties qui ont été volées, je veux les recopier avant de les oublier.
— Volées ? releva Quincy. Quoi donc ?
— Nous préparions un nouvel article sur l’époque de Faraldr, expliqua Mathilde. Malheureusement, un cambrioleur s’est introduit chez nous pour le dérober…
— C’est terrible. Very sorry, mademoiselle. Notre siècle va mal, si on se met à voler les historiens et les scientifiques !
Armand avala sa bouchée de petit pain, pensif. Quincy n’avait pas trahi le moindre sentiment autre que de la surprise et une curiosité bien plus vive que de la simple politesse. Cependant, il semblait s’être désintéressé de la question dès que Mathilde avait parlé de l’époque de Faraldr. Si les informations de Duclair étaient exactes, alors les deux Américains étaient ici pour se renseigner sur l’expérience de Monfort, pas sur ce que Faraldr pouvait leur apprendre de son temps.
Ses soupçons se confirmèrent durant la sortie. Quincy s’appliquait à jouer les touristes, mais Armand réalisa rapidement que tous les embranchements qu’il leur faisait prendre les menaient de plus en plus près du lieu de l’expérience initiale. Il l’y conduisit en riant sous cape : le manoir dont le parc était devenu si célèbre appartenait à un vieux savant de l’université de Rouen, malheureusement décédé depuis. Sa famille avait tout de suite vu l’intérêt d’ouvrir les lieux aux curieux, mais l’Empire avait mis son veto sur l’idée. Le manoir était à présent déserté et fermé. De toute manière, Quincy n’y aurait rien trouvé. Les machines de Monfort avaient disparu depuis longtemps, en même temps que le mystérieux professeur.
Les questions de Quincy tournaient aussi beaucoup autour de Monfort. Là, Armand n’eut pas besoin de mentir : aucun d’eux ne savait où il était, ce qui était d’ailleurs source d’importantes frustrations.
Lorsqu’ils rentrèrent sous une fine bruine glaciale, Armand en était persuadé : ils n’avaient pas le bon suspect.

— Ça pourrait quand même être lui, insista Joséphine.
— Pourquoi aurait-il volé la partie de nos recherches concernant Faraldr et laissé toutes nos observations et théories sur la faille elle-même ?
— On l’a surpris en rentrant, il a peut-être pas réalisé ?
— Les feuillets étaient froissés, objecta Armand. De toute évidence, ils ont été compulsés. Ils n’intéressaient pas le voleur.
Joséphine se rabattit sur sa chaise avec un soupir. Retour à la case départ. Dommage : elle avait entendu l’assistant, Jack Lowe, qui se moquait de Sleipnir, persuadé que personne ne parlait anglais. Elle ne se serait pas gênée pour lui dire le fond de sa pensée, et même un peu plus, s’il avait été impliqué dans le vol.
En face d’elle, Mathilde déballait un livre sur une des petites tables de la bibliothèque. Faraldr était assis sur le tapis devant le feu, profitant sans doute de savoir que madame d’Amoys était trop occupée pour venir voir s’ils se tenaient bien. Armand, enfin, faisait les allers et retours devant les fenêtres.
— Joséphine, voulez-vous me donner ce coupe-papier, s’il vous plaît ?
Elle hésita à le lancer à Mathilde, puis choisit plutôt de le lui tendre pour éviter toute catastrophe. Si elle abîmait un de ses livres, Mathilde ne le lui pardonnerait pas de plusieurs mois. En plus, l’ouvrage qu’elle venait de sortir de son paquet avait belle allure, déjà relié en cuir, avec des dorures sur les titres et un air de neuf qui respirait la richesse.
Aussi, lorsque Mathilde se saisit du coupe-papier et commença à découper les pages du livre sans la moindre hésitation, Joséphine manqua d’en tomber de sa chaise.
— Mais… ça va pas ? Qu’est-ce qu’il vous a fait, ce pauvre livre ? S’il vous plaît pas, vous pourriez le revendre, hein !
Mathilde releva vers elle un visage surpris, Armand s’arrêta d’arpenter le parquet et Faraldr se redressa.
— Oh, non, Joséphine, je ne l’abîme pas. Regardez, il faut couper les feuillets pour pouvoir le lire. C’est la méthode d’impression qui veut ça, les pages ne sont pas toutes séparées…
— Ah.
Joséphine observa la démonstration et réalisa une fois de plus que les gens riches vivaient vraiment dans un monde différent. Elle n’avait jamais vu ça – mais d’un autre côté, elle n’avait jamais acheté de livre neuf. Même maintenant, avec le salaire généreux qu’elle percevait de la part de la vieille dragonne, les romans qu’elle offrait parfois à Liberté n’avaient pas de belle couverture de cuir. Et les pages déjà coupées.
— Pour une fois qu’on file plus de boulot aux riches, marmonna-t-elle pour se donner une contenance.
Mathilde sourit en se remettant au travail.
— J’attendais ce livre avec impatience. C’est celui où a été publié notre dernier article, Faraldr, concernant le commerce du verre et de l’ambre.
À ces mots, Faraldr se leva pour venir se pencher par-dessus l’épaule de Mathilde, qui lui fit déchiffrer le titre sur la page. Armand s’approcha également.
— Le professeur Martel a donc décidé de diffuser vos nouvelles connaissances article par article ?
— Eh bien, c’est plus simple ainsi. Il faut beaucoup de travail pour rassembler les sources que nous utilisions jusqu’à présent et les confronter au témoignage de Faraldr. Et ensuite, pour rédiger tout cela, bien sûr.
— Si ce cher professeur n’était pas si intègre, on pourrait penser qu’il préfère aussi faire durer le prestige…
— Armand ! Tu sais bien que ce n’est pas ça.
— C’est prestigieux, d’écrire des articles sur le commerce du verre et de l’ambre ? demanda Joséphine sans vraiment y croire.
— Disons que ça l’est dans un certain milieu, répondit Armand en haussant les épaules.
Joséphine voyait parfaitement de quoi il parlait : ce milieu, elle le côtoyait depuis quelques mois grâce à Mathilde et aux conférences où elle s’était mise en devoir de traîner Faraldr.
— Ah, oui. Fabuleux.
— Quoi ? Vous n’appréciez pas la compagnie de tous ces éminents messieurs ? ironisa Armand.
— Sans façon, je vous les laisse. Ou à Mathilde.
— Croyez-moi, parfois je n’en veux pas plus que vous, marmonna cette dernière.
— Bon, on a qu’à les laisser au nouvel assistant du professeur Martel, alors, je suis sûre que c’est son truc. Comment il s’appelle, déjà ? Vélin ? Bélin ?
— Hénin, la corrigea Mathilde avec un rire. Monsieur Hénin, et vous avez tout à fait raison. Je ne veux pas médire, mais il est très conscient des questions de prestige scientifique. Vous auriez vu son visage lorsque le professeur Martel a insisté pour que je sois créditée au même titre que lui…
Joséphine ricana. Elle l’imaginait très bien.
— D’ailleurs…
Armand s’interrompit soudain, le doigt sur le menton. Joséphine se redressa, attentive : lui, il venait de calculer quelque chose.
— Mathilde… je n’y ai pas prêté attention, je pensais que c’était peut-être normal et nous ne savions pas encore tout à ce moment-là, mais… c’est assez inhabituel pour un assistant de se promener avec une canne, non ? Monsieur Hénin boite-t-il toujours ?
Faraldr se redressa aussitôt, les yeux écarquillés.
— Non, répondit-il. C’est la première fois qu’il avait une canne.
— C’est vrai, reprit Mathilde en abandonnant son livre. Je ne l’ai jamais vu boiter. Vous pensez que…
— Il sait où vous habitez, non ? demanda Joséphine.
— Oui, il a déjà accompagné le professeur Martel une fois.
— Et il sait que le professeur et vous êtes en train de travailler sur cet article. Ce rapport.
— Oui… C’est l’assistant du professeur, nous pouvions difficilement tout lui cacher. Mais nous lui avons fait promettre de ne rien dire. Oh, vous croyez qu’il aurait pu…
Faraldr ajouta alors quelque chose en norrois, d’un ton pressant. Joséphine contint son impatience pendant l’échange qui suivit. Elle avait appris quelques mots de norrois ces derniers mois, mais c’était surtout des jurons. Utile pour savoir à quel point elle faisait tourner en bourrique Faraldr aux cartes, mais pas pour comprendre une conversation.
— Apparemment, monsieur Hénin ignorait que nous devions rentrer si tôt du Danemark, leur apprit Mathilde d’une voix blanche. Il avait posé la question à Faraldr avant notre départ, mais Faraldr s’était trompé, il confond encore le cinq et le sept parfois…
Un silence s’abattit pendant quelques instants sur la bibliothèque, puis Joséphine se leva d’un bond.
— On retourne à Caen lui rendre une petite visite ?
— Et si nous le faisions plutôt venir à nous ? proposa alors Armand avec son air de renard. J’ai une idée…
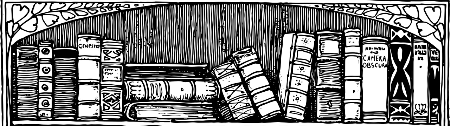
Mathilde entra dans le petit salon vert en retenant presque son souffle : ce qu’elle comptait tenter allait exiger un doigté qu’elle n’était pas certaine d’avoir. La pièce était bien rangée et ordonnée, ses tentures pâles auraient dû être apaisantes, mais l’air était tendu, et les domestiques qui défilaient constamment l’étaient tout autant. Mathilde s’immobilisa un instant sur le pas de la porte et observa avec curiosité sa mère, qui ressemblait plus que jamais au commandant d’une armada. Elle était toujours fascinée par ce spectacle, et avait terriblement conscience de ne pas avoir la moindre autorité comparée à Emma d’Amoys.
Puis celle-ci l’aperçut et lui fit signe d’entrer, tout en continuant à discuter avec Julie des dernières touches du menu. Le dîner allait être absolument splendide. Elle avait hâte de faire goûter de l’ananas à Faraldr ; sans doute n’en avait-il jamais vu.
— Mathilde, voici la liste des invités. Pourrais-tu te familiariser avec et t’assurer qu’Armand et monsieur Helgusson seront préparés ?
Mathilde retint une grimace, mais s’assit sans discuter devant la pile de feuilles que lui indiquait sa mère. Mieux valait s’attirer ses bonnes grâces avant de lui demander quoi que ce soit.
Tandis que sa mère se replongeait dans ses considérations sur la répartition des différentes compositions florales, Mathilde s’attela à sa propre tâche. L’écriture élégante de sa mère couvrait les pages, détaillant pour chaque nom les informations qu’elle jugeait essentielles au déroulement d’une telle soirée : des éléments marquants du passé connu de la personne, son poste et son statut familial, ses positions politiques et philosophiques, ainsi que des notes sur son caractère, ses affinités, et surtout, ce qu’il aimait et détestait le plus.
Mathilde se rappelait que, la première fois qu’elle avait été conviée à ce genre de préparatifs, elle avait été absolument époustouflée par la quantité d’informations que sa mère parvenait à amasser sur les gens qu’elle invitait à sa table – y compris ceux à qui elle venait juste d’être présentée. Elle avait regardé sa mère d’un autre œil après ça, et du haut de ses douze ans, se l’était imaginée en espionne impliquée dans des complots à la cour. Ce n’était bien sûr pas le cas, mais elle avait compris depuis qu’une bonne part de la réussite familiale était sans doute à mettre au crédit du talent d’Emma d’Amoys pour s’attirer les amitiés des uns et des autres. Elle était plus douée encore qu’Anne-Marie pour ce faire – et n’avait en général pas à composer avec une aussi forte tête que tante Henriette, ce qui lui facilitait quelque peu les choses.
Mathilde passa rapidement sur les voisins et s’attarda davantage sur les quelques noms qui lui étaient moins familiers. Il y avait un capitaine Jean de Graves, de la marine heureusement : Armand n’appréciait jamais de se retrouver confronté à d’anciens frères d’armes. Ce capitaine de Graves était apparemment un impérialiste convaincu, en faveur d’une position plus ferme en Asie, et préférait les mets exotiques à la tradition normande. Sa présence expliquait l’achat des trois ananas.
Il y avait aussi un professeur Leventon, éminent biologiste qui revenait tout juste d’une expédition en Afrique centrale. Étonnamment, il n’était pas pour la colonisation, malgré les opportunités que celle-ci lui avait ouvertes ; il faudrait veiller à ce qu’il ne croise pas trop souvent la route du capitaine de Graves. Il n’y avait rien concernant ses goûts : soit sa mère n’était pas parvenue à les obtenir via son réseau d’espionnage mondain, soit il aimait tout – ce qui semblait censé chez un homme passant la moitié de sa vie à parcourir les coins les plus reculés du globe. Nul doute qu’il aurait des questions pour Faraldr, mais au moins on pouvait raisonnablement espérer qu’elles soient intéressantes.
Elle prit le temps d’étudier la fin de la liste, puis la reposa soigneusement.
— C’est fait, maman. Puis-je faire autre chose pour vous aider ?
— Ta robe de soie grise a-t-elle été sortie comme je l’avais demandé ?
— Oui, maman, répondit-elle sans hésiter.
En vérité, elle n’en avait pas la moindre idée, mais si sa mère l’avait demandé, nul doute que cela avait été fait. Elle nota tout de même dans un coin de sa tête qu’il faudrait le vérifier rapidement.
— Très bien. Peut-être pourrais-tu t’assurer qu’Anne-Marie n’a pas besoin d’aide avec ta tante ?
— Bien sûr, dit Mathilde en se levant aussitôt.
— Mathilde.
— Oui ?
— Si tu as quelque chose à me demander, j’aimerais autant que tu le fasses maintenant, je vais être assez occupée pour le reste de la journée.
Mathilde s’efforça vaillamment de ne pas rougir sous le regard impitoyable de sa mère.
— Eh bien… Vous avez invité le professeur Martel, n’est-ce pas ?
— Oui. Il a répondu qu’il serait présent.
— Serait-il possible d’étendre l’invitation à son assistant, monsieur Hénin ? Je sais que c’est un peu tard, mais…
Emma d’Amoys fronça à peine les sourcils.
— Pourquoi donc ne l’as-tu pas dit plus tôt ?
— Eh bien… Je… Je n’y avais pas pensé, balbutia Mathilde. Mais en tant qu’assistant du professeur Martel, je crois qu’il serait approprié de…
— Mathilde.
Le regard que lui lançait sa mère ne présageait rien de bon et Mathilde déglutit.
— Qu’y a-t-il ? Il me semblait que tu n’appréciais justement pas ce monsieur Hénin.
Mathilde écarquilla les yeux, stupéfaite. Elle ne pensait pas avoir fait plus que simplement mentionner son remplaçant à sa mère.
— Je… Pas du tout…
— Oh, s’il te plaît, ma fille. Tu n’as jamais su dissimuler ton opinion des gens. J’ai bien vu ton regard quand tu as parlé de ce monsieur. Tu n’as pas à t’imposer sa présence. Personne ne s’attendrait à ce que nous l’invitions. Au contraire, cela fera même plutôt jaser.
— Pourquoi cela ferait-il jaser ?
— Un simple assistant n’a pas sa place au plus grand événement de l’hiver de toute la région, répliqua sa mère avec une assurance tranquille. Sa proximité avec le professeur Martel, et par extension avec toi, donnera des idées à tout le voisinage…
Elle s’interrompit et fixa sur Mathilde un regard perçant.
— Y aurait-il une part de vérité dans tout cela ?
— Comment ? Je… Mais non, voyons pas du tout. Vous avez raison, je n’apprécie pas le moins du monde monsieur Hénin. Il n’y a pas la moindre idée à se faire ! répliqua Mathilde en sentant ses joues lui cuire.
— Dans ce cas, Pourquoi veux-tu l’inviter ?
Mathilde chercha en vain une excuse, avant de réaliser qu’il valait mieux dire la vérité.
Elle lui raconta donc succinctement l’embarras dans lequel ils se trouvaient depuis le vol et les soupçons qui pesaient à présent sur monsieur Hénin. Sa mère écouta avec attention, imperturbable. Lorsqu’elle eut fini, Mathilde fit de son mieux pour paraître calme, malgré la nervosité qui lui nouait la poitrine. Sa mère ne dit rien durant quelques instants, puis soupira.
— Très bien, nous inviterons ce monsieur. J’aurais préféré que toi ou Armand nous en parliez tout de suite. Si cet homme est prêt à s’introduire chez des gens respectables pour parvenir à ses fins, il me semble que ce serait plutôt à la maréchaussée de l’arrêter.
— Nous n’avons pour l’instant que des soupçons. Et il faudrait que rien ne remonte jusqu’à monsieur Duclair…
— Le mensonge est un péché. J’avais pourtant bien dit à ton père que ta tante ne pouvait qu’avoir une influence délétère sur toi, mais j’espérais pouvoir faire confiance à ton cousin pour ne pas empirer les choses !
Mathilde baissa les yeux et subit les remontrances en silence, mais elle sentait le triomphe l’envahir : sa mère n’avait pas refusé leur plan. Elle ne pouvait pas dignement approuver, et nul doute qu’elle les surveillerait toute la soirée, mais elle ne les en empêcherait pas pour autant.
Il ne restait plus qu’à espérer que monsieur Hénin accepterait l’invitation… et qu’ils ne se trompassent pas dans leurs soupçons.
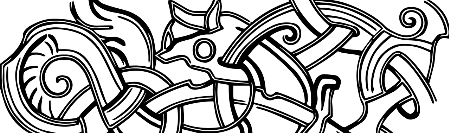
Faraldr devait avouer que madame d’Amoys était une dame et une hôtesse d’exception. Cette notion avait certes changé par rapport à ce qui lui était familier, mais l’accueil qu’elle réservait à chacun de ses invités, toute de grâce et de bonne humeur, lui évoquait les épouses des plus grands rois.
Il observait la piste de danse, massant sans vraiment y penser son bras droit : il était tard et le poids de la prothèse commençait à se faire sentir. Il n’aurait pas dû la mettre dès le matin, mais il répugnait à paraître devant des étrangers sans avoir au moins ce remplacement de son bras, et il avait encore du mal à considérer les parents de Mathilde comme autre chose que des étrangers. Les danses l’avaient rapidement fatigué. Mathilde n’avait pas menti sur ce point : il ne manquait pas de cavalières. Mais il était trop préoccupé pour apprécier leur compagnie.
— Monsieur Hénin est arrivé, lui apprit Armand en se coulant soudain à ses côtés. Mathilde discute avec lui et le professeur.
— Joséphine ?
— En place. Elle guette depuis l’appentis, personne ne partira sans qu’elle le voie.
— Je vais à la bibliothèque.
— Et moi je le surveille d’ici. Oh, n’hésite pas à prendre de quoi manger. Tu pourrais attendre un certain temps.
Faraldr hocha la tête, puis se mit en route. Sa progression fut lente : il avait déjà été présenté à presque tous les invités, mais on l’arrêtait régulièrement. C’était toujours ainsi depuis son arrivée et il commençait à s’y habituer, même si ce n’était pas forcément devenu moins agaçant lorsqu’il avait quelque chose de précis à faire. Il parvint à glaner une coupe contenant un morceau du fameux ananas dont Mathilde lui avait parlé, puis évita un petit groupe de convives à la conversation animée en se dissimulant derrière la porte de l’office. Les quartiers des serviteurs étaient plus bruyants encore, de la vapeur se dégageait de la cuisine et plusieurs jeunes filles qui n’étaient là que pour la soirée passèrent en courant à côté de lui, ne lui accordant qu’une œillade curieuse au passage.
Dès que la voie fut libre, il monta jusqu’à la bibliothèque où il se glissa dans l’ombre d’un des lourds rideaux. La vitre coulait un froid revigorant dans son dos. Il appréciait un peu de fraîcheur : les salles du rez-de-chaussée où se déroulait le bal étaient bien trop chauffées à son goût, mais il ne pouvait pas ôter son vêtement pour rester seulement en chemise. Il trancha un morceau d’ananas et porta la cuillère à sa bouche, avant d’émettre un grognement de satisfaction. Le goût était surprenant, mais bon, doux et piquant à la fois. Il le finit rapidement.
Puis il s’appuya contre la fenêtre pour attendre. Mathilde ou Armand devaient se charger de faire croire à Hénin que ce qu’il avait dérobé n’était qu’un leurre, et que le véritable rapport se trouvait dans la bibliothèque. Si le voleur tentait de s’y rendre, Faraldr n’aurait qu’à le prendre sur le fait.
Comme l’avait dit Armand, il pouvait en avoir pour un certain temps.
Il était en train de se demander s’il lui serait possible de redescendre chercher une boisson lorsque la porte s’entrouvrit. Faraldr se figea aussitôt. La pièce était seulement éclairée par le feu qui mourait lentement dans la cheminée. Dissimulé comme il l’était par le rideau, il était presque sûr de passer inaperçu, mais hors de question de prendre le moindre risque.
Un homme se glissa dans la bibliothèque avant de refermer rapidement la porte. Lorsqu’il s’avança dans la lueur que répandait encore le feu, Faraldr le reconnut immédiatement : c’était bien Hénin. L’assistant ne prit pas la peine de vérifier s’il était bien seul, mais se précipita plutôt vers la table, où Mathilde avait pris soin de laisser son écritoire… après l’avoir vidée. L’intrus hésita un instant, regardant alors autour de lui, puis ouvrit l’écritoire d’un seul coup.
Alors seulement, il eut un mouvement de recul et jura dans sa barbe.
— Il n’y a rien ici, lança Faraldr avec un grand pas en avant. Que cherchez-vous ?
Hénin sursauta si vivement qu’il manqua de tomber.
— Oh ! Monsieur Helgusson. Je ne vous avais pas vu. Je… Mademoiselle d’Amoys m’a demandé de bien vouloir lui amener son écritoire.
— Vous mentez, asséna Faraldr. Vous avez volé le travail de Mathilde. C’est vous.
— Je… Je…
— Pourquoi ? poussa Faraldr. Elle est toujours bonne et aimable avec vous.
— Bonne et aimable, cracha Hénin, le visage déformé par le mépris. Elle n’avait rien à faire au service du professeur Martel. Une dame n’a pas à s’immiscer ainsi dans le monde universitaire ! C’est indécent. Et qu’elle ose s’attribuer le mérite des recherches du professeur ! Son nom est déjà associé à deux articles. C’est inacceptable. Le professeur est aveuglé par son affection pour elle. Mais moi… si je pouvais publier ne serait-ce qu’un article… cela changerait toute ma carrière ! Ce n’est pas trop demander, si ?
Faraldr serra les poings pour contenir un mouvement de violence. Les lois de l’hospitalité étaient peut-être différentes à cette époque, mais il refusait d’attaquer un invité sous le toit des parents de Mathilde. Il était certain qu’ils n’approuveraient pas.
— Vous demanderez pardon à Mathilde, se contenta-t-il donc de dire. Et vous lui rendrez tout ce que vous avez volé.
Il n’eut qu’un instant pour réaliser ce que Hénin allait faire, et c’était déjà trop tard. L’assistant fit basculer d’un geste brusque l’écritoire, qui s’ouvrit avec un fracas de verre brisé. Les pots d’encre et de sable avaient dû se casser. Faraldr grimaça : Mathilde n’allait pas être contente. Il s’avança pour saisir le voleur sans ménagement, mais celui-ci renversa la table et partit en courant.
Faraldr sauta par-dessus la table, faillit chuter en dérapant dans l’encre, et lorsqu’il atteignit le couloir, ne put que voir les basques de l’habit de Hénin disparaître dans l’escalier. Il se précipita à sa suite, mais n’eut que le temps de le voir sortir par l’une des portes-fenêtres donnant sur la cour.
— Faraldr !
Armand surgit au bas de l’escalier et lui fit signe de le suivre. Il aperçut Mathilde qui accourrait, mais ils sortirent sans s’arrêter à l’attendre.
Dehors, la nuit était illuminée par les braseros et les torchères. Dans la cour se pressaient des véhicules en tous genres, voitures galvaniques et à cheval, ainsi que les cochers et conducteurs qui se réchauffaient auprès des feux. Faraldr repéra rapidement la silhouette de Hénin qui se faufilait entre deux attelages.
— Armand, là !
Ils bondirent à la poursuite de Hénin, mais furent pris de court en le voyant réapparaître soudain à dos de cheval. L’assistant talonna sa monture sans demander son reste et franchit le portail sous leurs yeux effarés. Faraldr jura avant de se tourner, impuissant, vers Armand.
— Et maintenant ?
— Maintenant, nous donnons la chasse. Jean ! Des chevaux, vite !

Joséphine était en train de se dire que la soirée ne donnerait rien du tout quand elle entendit des éclats de voix dehors. Elle fronça les sourcils, puis quitta son poste à la fenêtre pour sortir dans la cour, où elle aperçut Armand et Faraldr qui montaient à cheval.
— Qu’est-ce que vous faites ? lança-t-elle en accourant.
— Il est dans les champs ! répondit Faraldr, avant de partir au triple galop, aussitôt suivi d’Armand.
Joséphine jura, furieuse de l’avoir raté, puis s’avança en voyant Mathilde s’aventurer à son tour dehors, seulement vêtue de sa belle robe de bal grise.
— Joséphine ! Où sont-ils ?
— Hénin est parti à cheval, ils le suivent. Je guettais la route, je l’ai pas vu passer… Mais qui circule encore à cheval de nos jours ?
— Venez, prenons l’auto !
Joséphine ouvrit grand la bouche, prête à pointer du doigt que Mathilde n’était pas vraiment habillée pour une course-poursuite… mais la referma quand la demoiselle s’embarqua sans attendre dans la voiture familiale. Après tout, elle n’était pas sa mère.
Et puis, elle s’ennuyait depuis des heures, elle n’allait pas être en reste maintenant qu’il se passait enfin quelque chose.
Mathilde opéra un de ces démarrages en trombe dont elle avait le secret et l’auto jaillit hors de l’appentis au moment même où Joséphine finissait d’ouvrir le portail donnant sur la route. Mathilde s’arrêta juste assez longtemps pour laisser Joséphine s’engouffrer à bord, puis elle repartit en faisant voler les graviers.
— Avez-vous pu voir par où ils partaient ?
— Vers le village. Mais ils ont pris par les champs…
— Nous allons essayer de lui couper la route. Guettez-le !
Heureusement que le temps était dégagé, parce que les phares de la voiture n’éclairaient pas très loin et que Mathilde ne semblait pas vouloir ralentir. Joséphine poussa un cri lorsqu’une sorte de gros lapin bondit devant elles, mais Mathilde parvint à l’éviter avec une violente embardée qui manqua de les envoyer dans le décor.
— Doucement ! La route doit être gelée, avec cette neige. Vous allez pas nous faire tuer pour ce type, quand même !
— Je refuse de le laisser s’échapper !
Mathilde ralentit tout de même un peu. Joséphine moulina pour ouvrir la vitre puis se jucha sur le rebord de la portière, bravant la nuit froide pour tenter d’y voir dans les champs qu’elles longeaient.
— Là ! triompha-t-elle soudain. Je vois Faraldr et Armand. Ils vont à toute bringue, l’autre doit pas être loin…
Elle écarquilla les yeux et se hissa plus haut encore, priant pour que Mathilde ne fasse pas une nouvelle embardée, et fut récompensée.
— Je l’ai !
— Croyez-vous que nous allons pouvoir lui couper la route ?
— Il va le réaliser, il est pas bête…
— Ça reste à voir, marmonna Mathilde juste assez fort pour que Joséphine l’entende.
Elle trouva le moyen d’accélérer encore un peu plus et Joséphine se cramponna au châssis avec un cri étouffé. La route tournait à cet endroit, elles allaient se rapprocher de Hénin, mais s’il virait de bord avant…
— Hé, Mathilde ! lança soudain Joséphine, prise d’une idée. Les chevaux, ça a peur du bruit, non ?
— Quoi ? Oh, en général oui, mais… Oh ! Joséphine, c’est brillant !
— Attendez encore un peu…
Elle distinguait de mieux en mieux la silhouette de Hénin. Il était presque couché sur l’encolure de son cheval. Derrière lui, Faraldr et Armand s’étaient écartés, sans doute pour lui couper la route s’il tentait de tourner, mais ils étaient loin. Joséphine serra les dents.
— Encore… Encore… Maintenant !
Dans l’habitacle, Mathilde saisit la corne et appuya de toutes ses forces. Le vagissement sonore qui jaillit de la voiture fit presque sursauter Joséphine, même si elle s’y attendait ; le pauvre cheval, déjà affolé par la course, n’avait aucune chance. Il se cabra avec un hennissement strident et flanqua son cavalier par terre avant de repartir en sens inverse. Avant même que Mathilde ait fini d’arrêter l’auto, Joséphine sauta par-dessus le fossé et alla plaquer une botte dans le dos de Hénin, qui s’affaissa avec un gémissement.
— Ben alors ? On sait pas tenir à cheval ?
— Lâchez-moi, geignit-il d’une voix étouffée.
— Quoi ? J’entends pas. Vous avez dit « le voleur, c’est moi » ?
Une portière claqua et Mathilde apparut peu après, marchant lentement dans la neige – elle devait encore avoir ses chaussons de danse, mais Joséphine n’était pas vraiment étonnée de la voir s’aventurer dans le champ malgré tout.
— Monsieur Hénin ? Vous ici… Une petite promenade nocturne ? demanda-t-elle d’une voix parfaitement aimable.
Le voleur lâcha un grognement en laissant retomber sa tête dans une touffe d’herbe enneigée. Mathilde, les poings sur les hanches, se tourna vers Joséphine.
— Et maintenant, qu’allons-nous bien pouvoir faire de ce monsieur ?
— Mmh. On peut toujours le livrer à Faraldr, avança Joséphine en souriant de toutes ses dents, très amusée par le gémissement qui échappa à Hénin.
— Ou à ces messieurs de la gendarmerie.
— À l’armée ?
— Voyons, ils ont quand même mieux à faire. Quoique l’Empereur ne verrait sans doute pas toute cette affaire d’un bon œil…
C’était dur d’être sûre de nuit, malgré la luminosité de la lune, mais Joséphine avait l’impression que Hénin était à présent plus blanc que le champ autour d’eux. Elles poursuivirent leur petit jeu le temps qu’Armand et Faraldr les rejoignent, ce qui ne tarda pas. Faraldr tenait le cheval de Hénin par la bride.
— Mesdemoiselles, lança Armand d’un ton amusé, si vous avez fini de terrifier ce pauvre monsieur Hénin, je propose que nous le ramenions au manoir. Monsieur Martel saura quoi faire de lui, j’en suis sûr.
Joséphine se demanda si elle allait devoir relever l’assistant de force quand elle enleva son pied et qu’il ne bougea pas ; mais il finit par se redresser lentement. Il ne payait pas de mine, et apparemment il ne savait pas vers qui tourner son air le plus terrifié. Mais lorsque Faraldr descendit de cheval, elle crut qu’il allait vraiment tomber dans les pommes.
— Montez, fit-il en foudroyant Hénin du regard. Je vous dirai en route comment les voleurs étaient punis chez moi.
— Vous pourrez toujours écrire un article sur le sujet, persifla Mathilde.
Joséphine éclata de rire avant de l’entraîner vers la voiture pour laisser Faraldr et Armand reconduire le criminel de pacotille.
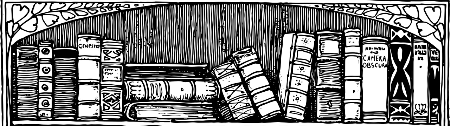
Mathilde sortit de la voiture avec trépidation. Avec un peu de chance, la majorité des invités n’auraient même pas réalisé leur absence ; sa mère, en revanche, ne l’ignorait certainement pas. Par le passé, Mathilde n’avait jamais été une jeune fille modèle. Elle avait déjà encouru l’ire de sa mère pour s’être cachée dans la bibliothèque durant une soirée entière, pour avoir repris un invité important sur sa conception erronée de l’histoire normande, pour s’être ridiculisée à la valse après avoir passé deux mois à éviter par tous les moyens son maître à danser…
Mais elle ne s’était encore jamais lancée dans une course-poursuite impromptue dans une des automobiles familiales.
Elle baissa les yeux sur sa robe, en ajusta les plis pour faire retomber la jupe correctement sur la cage de la crinoline. Elle ne semblait pas trop froissée, mais l’ourlet avait été trempé par la neige. Ses chaussures étaient en pire état, toutes tachées de boue.
— Mathilde, lui lança alors Joséphine. Par ici !
Elle se secoua et suivit la mécanicienne, résolue à faire face à la colère de sa mère. Ils avaient arrêté un voleur ce soir. Elle n’avait pas à en rougir.
Elle était si prête à affronter son sort qu’elle trébucha lorsque Liberté apparut comme par magie à la porte de l’appentis.
— Mademoiselle Mathilde ! Je vous ai amené d’autres chaussures. Laissez-moi voir votre robe…
— Oh, merci Liberté, souffla-t-elle, prise d’un si intense soulagement qu’elle en eut le tournis.
Il n’y avait pas grand-chose à faire concernant son ourlet, mais Liberté l’aida à nettoyer les quelques traces de neige boueuse. Changer de chaussures lui fit beaucoup de bien : elle commençait à avoir les pieds glacés. Enfin, une fois les dernières mèches rentrées dans son chignon, Mathilde serra les mains de Liberté.
— Merci. Et merci encore, Joséphine. Utiliser la corne était une idée brillante.
— Pas de souci. C’était la partie la plus intéressante de la soirée.
— Sans doute… Mais si vous souhaitez assister à une autre partie intéressante, rejoignez-nous dans la bibliothèque. J’y ferai monter le professeur Martel dès que possible.
— Je passerai le message à Faraldr et Armand quand ils arriveront, acquiesça Joséphine. Enfin… Si Faraldr a pas déjà balancé Hénin dans un fossé.
Mathilde secoua la tête, mais vit alors la porte d’entrée qui s’ouvrait de l’autre côté de la cour. Elle n’avait que trop tardé.
Elle trouva Julie dans le hall, qui l’emmena aussitôt à l’étage. Sa mère était là, les mains croisées d’une façon qui n’augurait rien de bon, devant la bibliothèque.
— Julie, pouvez-vous faire savoir au professeur Martel qu’il est attendu dans la bibliothèque, s’il vous plaît ? demanda Mathilde avant de perdre tous ses moyens.
— Oui mademoiselle.
— Prévenez aussi monsieur d’Amoys, intervint sa mère.
— Bien madame.
Avec une rapide révérence, Julie disparut dans les escaliers et Mathilde se retrouva seule.
— Viens, ordonna sa mère en se tournant pour ouvrir la porte.
Mathilde la suivit en tentant de calmer les battements de son cœur. Il fallait qu’elle soit plus raisonnable. Elle venait juste de se lancer dans une course poursuite effrénée et d’arrêter un homme. Pourquoi n’était-ce que maintenant, confrontée à la menace bien moindre de la désapprobation maternelle, qu’elle sentait des tremblements nerveux la secouer ?
Rien d’étonnant, vu l’état dans lequel elle se trouvait, qu’elle laissât échapper un cri de surprise devant le spectacle qui les attendait dans la bibliothèque.
— Enfin, mais que s’est-il passé ici ? s’exclama sa mère.
Mathilde se précipita pour ramasser son écritoire et constater l’ampleur des dégâts. Il y avait de l’encre partout et elle poussa un nouveau cri en se plantant un éclat de verre dans le doigt : tous ses flacons étaient brisés. Heureusement qu’elle avait enlevé ses papiers avant de laisser son écritoire comme appât !
— Fais attention, tu vas mettre de l’encre sur ta robe. Allons, aide-moi à redresser cette console.
— Oui maman.
— J’imagine que tout cela est à relier à ta soudaine envie de faire une promenade en automobile ?
— Eh bien… sans doute ?
— Mathilde.
Emma d’Amoys n’était pas une personne sujette aux hésitations. Pourtant, elle s’interrompit suffisamment longtemps pour que Mathilde relève la tête vers elle, surprise. Contrairement à ce à quoi elle s’attendait, sa mère n’arborait pas un air réprobateur. Au contraire : la bouche entrouverte, elle semblait ne pas savoir quoi dire.
— As-tu… as-tu seulement conscience des risques que tu prends ?
— Maman, personne ne m’a vue sortir. Je ne pense pas que…
— Je ne parle pas de ta réputation ! Crois-tu que j’ignore tout ce que vous avez fait en Islande ?
Cela coupa net Mathilde, qui était effectivement persuadée d’avoir réussi à dissimuler à ses parents une bonne partie de ses récentes aventures.
— J’ai lu les lettres de madame Göring à Anne-Marie. Et il n’a pas été difficile de nous renseigner. J’aurais préféré que tout cela vienne de toi, ma fille.
Mathilde détourna les yeux, partagée entre la culpabilité et l’envie de se défendre. Elle ne pensait pas avoir pris tant de risques que cela, et lorsque ça avait été le cas, c’était seulement parce qu’elle n’avait pas eu d’autre choix.
— Je suis désolée, maman, souffla-t-elle. Mais… c’était important. Vraiment important.
— J’en ai conscience, Mathilde. Et ton père et moi sommes tous deux fiers de ce que tu as fait pour monsieur Helgusson.
— Vraiment ? demanda Mathilde en relevant la tête, surprise.
— Bien sûr. Cependant, était-il essentiel que tu te mêles d’arrêter ce monsieur Hénin ?
— Oh, maman, je vous promets que nous n’avons pris aucun risque. Joséphine était avec moi dans l’auto. D’ailleurs, nous avons été utiles. Joséphine a eu l’idée de faire peur au cheval de monsieur Hénin avec la corne. Sans nous, il aurait peut-être échappé à Faraldr et Armand !
Sa mère ouvrit la bouche, puis secoua la tête.
— Très bien. Mais je t’en prie, à l’avenir, pourrais-tu laisser à ces messieurs ce genre d’exploit ?
Mathilde fit la moue, mais fut prise de court lorsque sa mère sourit d’un air malicieux.
— Après tout, que leur restera-t-il à faire si nous, pauvres femmes, ne leur laissons pas la primeur pour jouer les héros ?
Tante Henriette aurait bien sûr trouvé plusieurs arguments bien sentis à opposer à cela, qui vinrent aussitôt à l’esprit de Mathilde ; mais elle décida de garder le silence. Ses relations avec sa mère étaient suffisamment tendues pour qu’elle accepte avec joie cette entente.
— Bien. À présent, raconte-moi donc tout, en attendant que ces messieurs arrivent enfin.
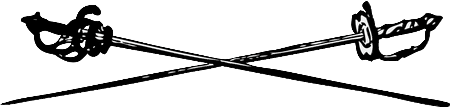
— Après le dernier chant, nous sortirons de l’église, expliqua Armand à mi-voix à Faraldr.
Il n’eut pas le temps d’en rajouter davantage : les voix s’élevaient déjà autour d’eux dans une harmonie relative et assourdissante. Les chants des messes de Noël étaient toujours très appréciés. Même Faraldr se joignit au refrain après quelques instants d’écoute. De là où ils se trouvaient, Armand apercevait Mathilde chanter en chœur, même s’il était presque certain qu’elle se contentait de bouger les lèvres. Un peu plus loin, dans la foule qui se pressait derrière les bancs réservés aux notables locaux, Joséphine et Liberté participaient de bon cœur. Liberté paraissait particulièrement enthousiasmée par les chants de Noël, et son visage rayonnait. Même Joséphine, sans doute contaminée par l’enthousiasme de sa petite sœur adorée, n’avait pas la mine renfrognée qu’elle adoptait souvent quand elle venait à l’église du village.
Non qu’Armand l’aurait condamnée pour cela. Si le personnel des d’Amoys s’était vite habitué aux deux sœurs, leur origine de la si lointaine Guyane déstabilisait encore nombre de locaux qui n’avaient jamais connu autre chose que la Normandie en-dehors des journaux. L’attention qu’elles attiraient n’était pas toujours exprimée de la manière la plus agréable qui soit.
Mais ce soir, tout allait bien. Personne ne semblait observer particulièrement ni Joséphine et Liberté, ni Faraldr ; un excellent repas les attendait en arrivant ; et ils avaient pu récupérer le jour même les papiers volés par Hénin, mettant un terme définitif à toute cette affaire sans même avoir à prévenir Duclair. Avec un peu de chance, ce dernier n’en saurait jamais rien.
Armand ne pouvait s’empêcher d’éprouver un peu de pitié pour ce pauvre Hénin quand il repensait au bal des d’Amoys. Il ignorait qui, de Faraldr, Joséphine, Mathilde, des parents de celle-ci ou du professeur Martel, avait fait passer le plus mauvais quart d’heure au malheureux assistant. Voilà un homme qui ne ressortirait pas du droit chemin de sitôt – et qu’on ne reverrait sans doute pas en Normandie.
Mais son empathie ne durait jamais longtemps. Il lui suffisait de se remémorer le ton venimeux qu’il avait pris pour accuser Mathilde de tous les maux, et soudain le sort de monsieur Hénin redevenait amplement mérité. Sans compter qu’après tout, il aurait pu être bien pire. Leur volonté de garder le vol secret lui avait permis d’échapper à un jugement pour son crime. Il en était quitte pour devoir jouer les larbins auprès du professeur Martel, qui voulait l’avoir à l’œil… Ce qui n’était pas si éloigné de l’emploi d’assistant qu’il convoitait, en fin de compte.
Le chant s’acheva, sortant Armand de ses pensées. Il se signa une dernière fois en se morigénant d’avoir laissé son esprit dériver ainsi dans un lieu sacré, puis suivit Faraldr dans la cohue de la foule qui vidait lentement les lieux.
— Alors, comment as-tu trouvé cette messe ?
— De beaux chants, approuva le Normand. Mais je ne comprends toujours pas la communion. Le pain et la chair. C’est vrai ?
Faraldr, s’il avait affirmé avoir été baptisé, ne communiait pas pour autant. L’archevêque de Rouen, dépêché pour donner son avis sur cette situation délicate, en avait conclu qu’il valait mieux pour l’instant le considérer comme un jeune enfant, qu’il convenait d’éduquer par un catéchisme approprié avant de pouvoir le laisser accéder au sacrement.
Bien sûr, le fait qu’il vive chez les d’Amoys posait quelques problèmes. Si Emma d’Amoys comme Anne-Marie de Haurecourt étaient des modèles de vertu d’un point de vue religieux, c’était loin d’être le cas pour Charles et la vieille dragonne, qui avaient apparemment été élevés par des parents dont l’anticléricalisme frisait l’athéisme. Mathilde allait relativement régulièrement à l’église et ne participait pas aux débats infernaux qui animaient parfois la maisonnée, mais Armand était convaincu qu’elle était au fond partagée sur la question.
C’était quelque chose d’assez déstabilisant que ce manque de foi chez sa cousine, mais il avait appris à garder pour lui son opinion sur ce genre de sujet. Cela valait mieux pour tout le monde, chez les d’Amoys.
— Eh bien… je ne suis peut-être pas le plus à même de t’expliquer des points de théologie aussi délicats.
— Je demanderai à Mathilde.
— Essaie plutôt avec mademoiselle de Haurecourt. Ou Liberté, peut-être…
Ils saluèrent l’officiant puis allèrent retrouver les dames, qui s’étaient réunies un peu plus loin sur le parvis et discutaient avec des connaissances.
— … lancer la pelote !
Armand se tourna vivement vers un groupe de jeunes gens qui venaient de les dépasser, et qui avaient tous l’air plus excités les uns que les autres.
— Je pensais pourtant que la pelote avait été interdite cette année, marmonna-t-il pour lui-même.
— La… comment ? demanda aussitôt Faraldr, toujours aussi attentif.
— La pelote. C’est une tradition. On prépare une bourse d’argent que la dernière mariée de l’année doit lancer, et celui qui parvient à l’attraper puis à la ramener chez lui la gagne.
— Ah. Un don généreux.
— C’est surtout l’occasion de beaucoup de bagarres et de coups bas ! Elle ne devait pas avoir lieu cette année, j’ai entendu monsieur le préfet en parler récemment…
Mais au vu de la tension ambiante et des petits groupes qui se réunissaient d’un air furtif sur le parvis, la gendarmerie risquait d’avoir fort à faire si elle voulait vraiment faire tenir l’interdiction.
— Hé, m’sieur Faraldr ! Vous vous joignez à nous ? lança un gaillard qui était sans doute plus grand encore que leur Viking.
Armand était toujours étonné par la rapidité avec laquelle Faraldr semblait s’être fait une multitude de connaissances dans les environs.
— Armand ? Est-ce interdit par la loi ?
La question était posée avec une telle solennité qu’Armand hésita un long moment. Techniquement, il doutait qu’il existât la moindre loi concernant la pratique de la pelote les soirs de Noël en Normandie. Mais il était certain que le préfet ne serait pas ravi d’apprendre que le célèbre Viking de France avait participé à une activité qu’il venait d’interdire.
D’un autre côté, monsieur le préfet était un homme pompeux, vaniteux et absolument insupportable, qui avait ouvertement dédaigné la compagnie d’Armand comme de Mathilde à deux occasions depuis leur retour en Normandie.
Et puis, tout le monde lui serait reconnaissant de trouver un moyen d’éloigner Faraldr du Bec. Il y avait encore quelques préparatifs en cours là-bas pour la petite surprise concoctée par sa cousine.
— Non, ne t’inquiète pas. D’ailleurs, je suis sûr que Mathilde t’encouragerait à apprendre les traditions françaises. Allons-y tous les deux. Je vais prévenir les dames de ne pas nous attendre. Ne t’en fais pas, ajouta-t-il en voyant le froncement de sourcils de Faraldr, elles peuvent rentrer sans nous, elles ont presque tous les domestiques pour les accompagner.
Il se hâta d’aller abandonner son manteau à Mathilde.
— Armand, mais que fais-tu ?
— J’initie Faraldr aux traditions normandes. Nous vous rejoindrons dans… oh, une ou deux heures tout au plus.
— Quoi, ils vont faire la pelote ? fit Joséphine en s’approchant.
— Il me semble bien. Voulez-vous venir ?
— Non, non… J’ai déjà gagné l’an dernier. Ça serait pas juste. Et puis, faut aider pour la…
— Joséphine ! siffla Mathilde pour la faire taire
— Vous n’allez tout de même pas participer à cette activité ? demanda Emma d’Amoys, l’air si atterrée qu’Armand ressentit une pointe de culpabilité.
— Je crois que Faraldr l’apprécierait beaucoup, se justifia-t-il.
La mère de Mathilde semblait sur le point de poursuivre, quand, fort heureusement, une explosion de cris retentit : la partie avait commencé.
— Mesdames, je dois aller aider notre ami. Faraldr, sur ta gauche !
Et sans attendre d’autres remontrances, Armand se jeta dans la mêlée.
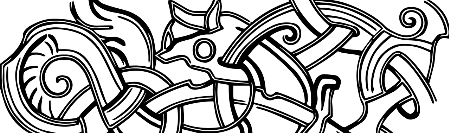
— Et voilà comment on fête Noël en Normandie !
Faraldr ponctua la phrase d’Armand en brandissant sa prothèse, qu’il avait ôtée depuis le début du jeu de pelote pour ne pas se faire mal. Ils manquèrent alors tomber tous les deux, déstabilisés par le mouvement. Il rattrapa le Français et l’aida à recaler son bras en travers de ses épaules, afin de le soutenir tandis qu’il avançait en boitant.
— Désolé. Ce fossé était vraiment traître. Je crois que je ne vais pas pouvoir utiliser cette cheville durant une semaine…
— Heureusement, tu ne t’es rien cassé, observa Faraldr.
— Mon honneur est peut-être fracturé. Au moins fêlé, se plaignit Armand, mais d’un ton trop léger pour être sérieux.
— Peut-être Gunnar peut te fabriquer une prothèse, pour ton honneur.
Son compagnon tourna vers lui un visage stupéfait, avant d’éclater de rire.
— J’en doute. Ce serait bien au-dessus de mes moyens, de toute manière. Ah, il faut dire « peut-être que Gunnar ».
— Peut-être que, répéta Faraldr avant de soupirer. « Que » est le pire mot de la langue française. Il est partout, même quand ça n’a aucun sens.
— Pas du tout. La langue française est éminemment logique. Cartésienne.
— Car… comment ?
— Cartésienne. Cela vient du nom d’un philosophe…
Ils achevèrent le trajet jusqu’au manoir au son des explications d’Armand sur les philosophes français, que Faraldr cessa rapidement d’écouter. Habituellement, il se serait appliqué à en retenir le plus possible, mais ce soir il n’en avait pas envie. Sans doute était-ce à cause de la période de l’année, où en temps normal il aurait été de fête en fête pour célébrer Jòl comme il se devait. La première année après son bannissement, il avait éprouvé une terrible mélancolie lorsqu’il avait dû se contenter des festivités du port où se trouvait le marchand qui l’avait pris à son service. Après cela, il avait eu, au service du Jarl de Normandie, une forme de camaraderie qui avait rendu la séparation d’avec les siens moins difficile.
Mais cette année, c’était pire encore que cette toute première fois. Alors il se concentrait sur les étoiles, pour essayer de retrouver dans le ciel quelque chose de familier. Plus personne ne festoyait comme dans son temps, toute croyance en ses dieux semblait avoir disparu. Même les célébrations des chrétiens ne ressemblaient pas à ce à quoi il avait pu assister.
— Ah, on dirait que nous sommes attendus…
Faraldr rabaissa la tête. Armand avait raison : un grand brasier éclairait la cour du manoir, ses flammes plus éclatantes que les lumières galvaniques. Lorsqu’ils s’en approchèrent, la porte d’entrée s’ouvrit et Mathilde apparut.
Elle avait défait son habituel chignon et arborait à la place une longue tresse qui serpentait sur son épaule. Sa vêture était également différente : sous un superbe caftan de laine verte, on distinguait les couleurs et les broderies d’une robe-tablier. Lorsqu’elle s’avança, son manteau s’écarta pour laisser entrevoir les broches ciselées qui attachaient les bretelles de sa robe et plusieurs rangées de perles qui luisaient à la lumière dansante des flammes.
Faraldr manqua d’en faire tomber Armand sous le coup de la surprise. Il n’aurait jamais imaginé la voir ainsi vêtue. Elle semblait venue tout droit de son monde à lui, et cela la changeait tant qu’il s’en trouva intimidé.
— Faraldr Helgusson, bienvenue, lui dit-elle en norrois.
Derrière elle, plusieurs autres personnes sortaient à leur tour, toutes habillées à la manière de son temps. La mère de Mathilde était plus impressionnante qu’une prêtresse ; son père portait une splendide cape d’un pourpre royal. La vieille dragonne, Anne-Marie, Liberté, Julie… Pierre vint aider Armand à s’écarter ; le Français lui fit un clin d’œil avant de grimacer lorsqu’il s’appuya trop sur son pied.
Puis Mathilde s’approcha, une coupe entre les mains.
— Partage notre table et notre célébration. Considère cette maison comme la tienne.
C’est ce qu’une maîtresse de maison aurait pu dire ; ce qu’il lui avait appris en lui parlant de son temps, de ses coutumes. Normalement, ce rôle aurait dû revenir à sa tante, la véritable matriarche, ou à sa mère, selon les cas. Ce qu’elle venait de faire aurait été le signe d’une préférence à son égard, d’une permission à lui faire la cour ; mais cette entorse à la tradition ne le dérangea pas, au contraire. Il était heureux de recevoir cette coupe des mains de Mathilde. Elle signifiait bien plus ainsi.
Il prit la coupe et but une gorgée. Cette fois, il ne fut pas surpris de sentir la chaleur douce de l’hydromel sur sa langue ; il ne s’attendait à rien de moins. Il lui rendit la coupe avec un remerciement solennel. Elle but alors à son tour, puis tenta de dissimuler une toux sans grand succès. C’était un bon hydromel, mais il était assez fort : comme pour tout dans ce siècle, l’abondance régnait et celle qui l’avait brassé avait utilisé beaucoup de miel.
La coupe passa de main en main, puis des plats apparurent sur les tables sommaires qui avaient été dressées autour du feu de joie. Faraldr inspira les odeurs alléchantes, en reconnut certaines et se tourna vers Mathilde, la gorge serrée par l’émotion.
— Tout ça, c’est…
— Un cadeau, pour toi. C’est… enfin, ce doit être difficile, d’être si loin des tiens. Je sais que ce n’est pas pareil, mais j’espère que nous n’avons pas commis trop d’erreurs…
Ils s’approchèrent d’une des tables et Julie lui détailla les plats avant de les lui faire goûter. Gibiers rôtis, ragoût de mouton, légumes racines parfumés de miel et d’épices, galettes de céréales et bouillons de poissons ; il eut l’impression d’être rentré chez lui, à ceci près que même chez son oncle, il n’avait jamais fait aussi bonne chère.
— C’est parfait, dit-il enfin. Mathilde, c’est… Merci.
Elle sourit, les joues rouges – il était prêt à parier qu’il ne s’agissait pas de la lueur du feu.
— Je t’en prie.
— Alors ? Il aime ? demanda soudain Joséphine en lançant un bras par-dessus l’épaule de Faraldr.
Elle aussi avait fait l’effort de se vêtir à la mode ancienne, même si les pantalons et la tunique qu’elle portait auraient bien sûr convenu davantage à un homme. En temps de festin, jamais aucune femme n’aurait songé à s’habiller ainsi, même les combattantes. L’espace d’un instant, il fut choqué, mais il se reprit aussitôt. Il n’avait pas réalisé qu’il parlait toujours en norrois avec Mathilde.
— Oui, répondit-il en français. J’aime beaucoup.
— Super. Bon, qu’est-ce qu’on fait dans les festins chez toi, à part manger et boire ? Y a des jeux ?
— Bien sûr. Il faut savoir qui a le plus d’adresse. Et de force. Le meilleur scalde. Et…
Il continua d’énumérer tandis que Joséphine déclamait le début des concours et que Mathilde le regardait avec un grand sourire. Pierre l’emmena s’habiller de vêtements comme il n’en avait pas porté depuis des mois, et il dut prendre un moment pour contenir son émotion. Voir son bras blessé dans une tunique teintait sa joie d’amertume, mais il ne s’y attarda pas : tout le monde l’attendait.
La suite de la nuit se partagea entre joutes et festoiement. Armand, qui avait été installé sur une chaise pour soulager sa cheville foulée, dut décliner les épreuves de force, que Faraldr remporta aisément malgré la concurrence des valets et domestiques. Charles d’Amoys s’illustra brillamment dans les épreuves d’énigme, même si de l’avis de Faraldr Mathilde aurait pu remporter ce prix, car traduire d’une langue à l’autre les subtilités des différentes formules était assurément plus difficile encore que de les élucider. À la surprise de tous, la vieille dragonne gagna le titre de meilleur scalde : elle s’avéra très douée pour les kennings.
Puis Faraldr passa un long moment à faire part de sa reconnaissance aux femmes de la maisonnée, qui avaient réalisé toutes ces tenues, en octroyant une considération particulière à Liberté pour les magnifiques broderies qu’elle avait réussies. Il remercia également Julie pour tout le travail qu’elle avait abattu, loua la qualité de son hydromel, car il était évident que ce n’était pas madame d’Amoys qui l’avait brassé. Enfin, il s’inclina bien bas devant ses hôtes.
Les danses et les chants se succédèrent, mélange de chansons que Faraldr s’efforça d’apprendre à tous, puis d’autres que les Français connaissaient mieux. Liberté et Joséphine partagèrent aussi avec eux des airs traditionnels de leur pays natal, dans une langue étrange, qui semblait louvoyer avec le français sans jamais s’y soumettre totalement.
Lorsque le soleil pointa à l’horizon, le feu de joie en était réduit à des braises. Joséphine s’était effondrée sur un banc, les yeux à moitié ouverts, à l’abri sous plusieurs couvertures ; elle caressait doucement la tête de Liberté, qui dormait dans son giron. Armand somnolait également dans son épais manteau bordé de fourrure, le pied relevé, une coupe d’hydromel à la main. Le tonneau devait être vide. Mathilde était en train de griffonner quelque chose sur une feuille qu’elle avait dénichée quelque part, Faraldr ignorait où. Il s’approcha pour tenter de déchiffrer les lettres par-dessus son épaule, sans succès. Il n’était pas encore assez savant.
— Je voulais noter les paroles de cette chanson avant de les oublier, lui dit-elle, toujours en norrois, comme si c’était pour elle la chose la plus naturelle au monde.
— Je te les chanterai à nouveau.
Elle se redressa alors puis dissimula un bâillement derrière sa main.
— Le jour se lève déjà… As-tu passé une bonne nuit ?
— C’était parfait. Cela faisait longtemps que je n’avais pas autant eu l’impression d’être chez moi.
Mathilde sourit, puis Faraldr se releva, soudain décidé.
— Viens. J’aimerais faire quelque chose.
Ils se rapprochèrent d’Armand, de Joséphine et de Liberté, qui ne se réveilla même pas. Armand fit de son mieux pour se redresser, mais Faraldr l’arrêta d’un geste.
— Je veux vous dire quelque chose, commença-t-il en repassant au français. Je vous dois beaucoup. Vous m’avez aidé et sauvé depuis que je suis arrivé ici. Ce repas, cette fête… Merci.
— C’était un plaisir, l’assura Armand. Nous devrions faire des célébrations nordiques plus souvent. L’hydromel était fameux.
Joséphine, quant à elle, se contenta de sourire.
— Je veux vous dire aussi que… Je vous ai déjà parlé du felag. Le… Mathilde ? demanda-t-il, incapable de retrouver le mot en français.
— On pourrait le traduire par communauté.
— Communauté. C’est quelque chose que l’on se jure, chez moi, de faire felag. Faire communauté. Je veux le jurer, envers vous. Vous pourrez toujours compter sur moi.
Mathilde entrouvrit la bouche, l’air émue, et Armand se redressa sur son siège. Joséphine s’était complètement immobilisée.
— Et tu pourras toujours compter sur nous aussi, finit par dire Mathilde. Enfin…
Elle se tourna vers les autres Français en rougissant, mais Armand secoua la tête.
— Bien sûr. Faraldr a raison, nous formons un felag. Faraldr, je jure que tu pourras aussi toujours compter sur moi. Que vous pourrez toujours compter sur moi, ajouta-t-il en regardant Mathilde puis Joséphine. Même si vous avez pu croire le contraire, sachez que je prendrai toujours votre parti dans l’adversité.
— J’ai été injuste envers toi, s’excusa Mathilde. Je ne douterai plus, je te le promets. Armand, Joséphine, Faraldr… S’il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous, alors je le ferai.
Joséphine resta silencieuse un moment de plus, ses yeux se posant rapidement sur chacun d’eux, puis sur Liberté. Enfin, elle haussa les épaules.
— Pareil. Sauf si ça risque de mettre en danger Liberté, mais sinon… pareil.
Faraldr hocha la tête et tenta de contenir son émotion. C’était loin d’être un serment de felag habituel, mais pour leur situation, cela paraissait plus approprié.
Ensemble, ils regardèrent le nouveau soleil se lever sur la campagne endormie.
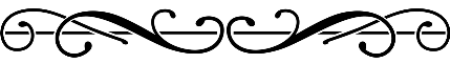
J’espère que vous avez passé un bon moment en Normandie ! N’hésitez pas à venir discuter traditions de Noël et expériences gustatives en commentaire.
