De la Musique et des Mœurs
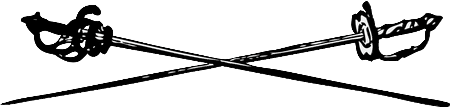
Armand du Thouars n’était pas de très bonne humeur ; mais il ne pensait pas avoir à s’en défendre, au vu de la nouvelle que le courrier de la veille lui avait apportée.
Il replia la lettre officielle lui signifiant sa libération du corps des armées de l’Empire et la posa soigneusement sur la table de chevet. Il évita de s’attarder sur l’imposante armoire, au fond de laquelle se trouvait la boîte renfermant son uniforme, et se leva plutôt pour aller se poster à la fenêtre. Le domaine du Bec s’étendait devant lui, avec ses jardins d’agrément colorés et son petit bois. Le soleil de juillet achevait de chasser la brume matinale. Il aperçut l’une des jeunes servantes qui revenait du potager, un panier rempli sur le bras, une main levée pour s’essuyer la nuque. Encore une belle journée d’été qui s’annonçait ; et lui n’était plus qu’un civil, échoué là, incapable de savoir ce qu’il allait faire de sa vie à présent.
Il soupira et se frotta vivement le visage pour se tirer de ces idées moroses. Il avait eu une chance inouïe d’éviter la cour martiale pour haute trahison ; il ne savait certes pas de quoi allait pouvoir être fait son avenir à présent, mais les opportunités ne manquaient pas. Il n’avait que vingt-trois ans, il était de bonne famille, et surtout, il était le cousin de Mathilde d’Amoys, dont la réputation était en passe de se faire dans toute l’Europe comme la « découvreuse du Viking ».
Sa cousine avait beau rougir de ce surnom, et le Viking en question trouver la notion d’avoir été découvert singulièrement comique, il n’en restait pas moins qu’appartenir à l’entourage de Faraldr Helgusson, authentique Normand sorti quelques mois plus tôt d’une faille temporelle, était une chance dont tous ne disposaient pas.
C’était l’armée qui finirait par le regretter et non l’inverse, il s’en fit la promesse.
Puis, comme tout jeune homme en passe de se construire un brillant avenir, il décida de commencer sa journée par un solide petit-déjeuner.
La petite salle à manger, aux murs tendus de délicates soieries jaunes, n’abritait à cette heure qu’Henriette d’Amoys. Elle releva les yeux du journal étendu devant elle lorsqu’il entra, avant de les rabaisser sans autre forme de procès. Armand s’attabla à une distance respectable. Il existait une sorte de trêve tacite entre lui et l’acariâtre tante de Mathilde : tant que les dix heures du matin n’avaient pas encore sonné (une heure déjà tardive en province, où tout le monde se levait bien plus tôt qu’à Paris), ils étaient libres de s’ignorer, sans faire le moindre effort de courtoisie qui pourrait aboutir à une dispute.
André, un jeune valet, vint lui servir son café et lui amener du pain frais avant de reculer en manquant s’emmêler les pieds dans le tapis ; Henriette d’Amoys braqua sur lui son regard terrifiant, mais ne dit rien – un signe de bonne humeur tel qu’Armand n’en avait pas vu chez elle depuis qu’ils étaient rentrés de leur périple.
Tout en savourant le goût du beurre normand, qui ne se retrouvait décidément nulle part ailleurs, Armand consulta sa montre. Neuf heures. Mademoiselle de Haurecourt, la compagne de Henriette d’Amoys, devait prendre son petit-déjeuner dans sa chambre – c’était la seule dame à agir selon les règles les plus strictes de la bienséance, dans cette maison. Faraldr s’était sans nul doute levé aussi tôt que d’habitude et devait être en train d’arpenter les terres du manoir : il aimait particulièrement discuter avec les métayers du domaine, voire même les aider dans leurs travaux. Les cuisines n’avaient même plus besoin d’envoyer des servantes chercher la viande et le lait : il revenait toujours les bras chargés des victuailles remises par les fermiers, qui l’appréciaient beaucoup.
Clairement, le règne de terreur des Vikings sur les campagnes françaises avait pris fin.
Mathilde entra, le nez plongé dans un livre, comme à son habitude, et vint s’asseoir en face de lui en murmurant à peine un « bonjour ». Quelques instants plus tard, sa tante se levait pour quitter la table, les laissant seuls. Armand patienta quelques instants ; mais comme toujours, sa cousine était trop intéressée par sa lecture pour se montrer de compagnie agréable, et il finit par se lever pour venir étudier de plus près le titre du livre qui la fascinait tant. Il déchanta rapidement : c’était encore de l’islandais.
— À force, tu ne sauras bientôt plus parler français…
Elle se contenta de lever les yeux au ciel, mais il avait réussi à la tirer de sa lecture ; elle reposa le livre et but une gorgée de chocolat.
— Armand, peut-être pourrais-tu m’aider… te souviens-tu du titre de ce livre que nous lisions, enfants ?
— Tu vas devoir être plus précise, j’en ai peur…
— Celui qui contenait le récit sur la fête de la Sainte Lucie. Je voulais le raconter à Faraldr, j’aimerais savoir si cette coutume pouvait être déjà présente sous une forme ou une autre à son époque.
— Ah, je crois que je vois de quoi tu parles… non, j’ai bien peur de ne pas me rappeler le titre. Par contre, je me souviens du livre. Il avait une couverture rouge, avec un liseré un peu effacé par endroits… je vais t’aider à le chercher.
— Oh, merci. La bibliothèque est bien trop grande pour que j’y parvienne toute seule.
Armand leva un sourcil, amusé d’entendre sa studieuse cousine se plaindre d’avoir trop de livres sous la main ; mais elle ne lui laissa pas le temps de la taquiner sur le sujet, se levant d’un bond pour l’entraîner à sa suite.
— Viens, allons voir…
Ils passèrent une bonne partie de la matinée à fouiller la bibliothèque. Il s’agissait d’une pièce immense, presque aussi grande que la salle de bal, dont certaines étagères n’étaient accessibles qu’à l’aide d’une échelle. Un ingénieux système à air comprimé permettait de déplacer celle-ci le long de plusieurs rails de laiton, permettant de faire le tour de la pièce sans même avoir à redescendre.
Armand se permit quelques allers et retours, en souvenir de son enfance. Il lui arrivait encore parfois de se demander si ce n’était pas cette échelle, et l’impression de voler qu’elle lui conférait alors, qui avait éveillé en lui le désir de devenir pilote d’aéronef.
— Il n’est pas là, soupira Mathilde en se laissant tomber dans l’une des confortables bergères. Enfin, c’est inouï, un livre ne peut pas simplement disparaître…
— Allons, faisons une pause. Où est Faraldr ?
Le mentionner suffisait en général à mettre Mathilde de bonne humeur – cela ne lui avait pas échappé, mais il se demandait encore si cela signifiait autre chose qu’un simple attachement amical. Après tout, la situation de sa cousine vis-à-vis du Viking, dont elle avait sauvé la vie et à qui elle servait encore souvent d’interprète, ne pouvait que conduire à une certaine proximité entre eux.
— Peut-être est-il avec Joséphine et sa sœur… je crois qu’elles devaient aller au marché ce matin, il avait proposé de les accompagner. Quelle heure est-il ? Oh, si tard ? Ils doivent déjà être rentrés.
Ils descendirent donc à l’ancienne grange. À l’intérieur était installé leur magnifique voilier aérien, Sleipnir. Comme ils s’y attendaient, ils entendirent dès leur entrée un sifflotement en provenance de l’arrière du hangar, bientôt suivi d’un éclat de rire cristallin.
Joséphine était penchée sur son atelier, protégée par un masque métallique et un épais tablier en cuir ; elle soudait quelque chose, à en juger par les gerbes d’étincelle qui jaillissaient autour d’elle. À quelques mètres de là, Faraldr et Liberté étaient assis sur des caisses ; Liberté était occupée à un ouvrage de broderie tandis que le Viking lui racontait quelque chose à grands renforts de moulinets de son bras gauche.
— Tiens, v’là les lève-tard ! lança Joséphine d’un ton moqueur.
Faraldr se leva pour les saluer ; Liberté s’empressa de l’imiter en époussetant sa jupe, sans lâcher son ouvrage. La sœur de Joséphine avait la même peau noire et les mêmes cheveux crépus que son aînée – mais la ressemblance s’arrêtait là : la cadette parlait d’une voix douce, était toujours délicate, et même en ce moment, debout au milieu de vieilles caisses dans un hangar, elle semblait aussi raffinée que s’ils s’étaient trouvés dans un salon. La légère révérence qu’elle fit aurait sans doute satisfait même la tatillonne mère de Mathilde.
En comparaison, Joséphine se contenta de s’appuyer sur son établi et d’enlever ses gants avant de lancer :
— Alors, on fait quoi aujourd’hui ?
À ces mots, Mathilde poussa un soupir. Armand secoua la tête avant d’expliquer :
— Nous cherchons un livre.
— Ah… z’avez essayé la bibliothèque ?
— Bien sûr, nous ne sommes pas… s’indigna-t-il, avant de s’interrompre en surprenant l’air goguenard de la mécanicienne.
Il n’eut pas le temps de trouver quoi rétorquer que Faraldr s’approchait de Mathilde :
— Peut-nous aider ?
— Pouvons-nous, le corrigea-t-elle machinalement. Je ne pense pas, nous venons de passer toute la bibliothèque au crible, je ne vois pas où…
Soudain, elle s’interrompit avant de porter une main à son front.
— Mathilde ?
— Mais bien sûr ! Il doit être dans la salle d’étude, comment n’y ai-je pas pensé plus tôt ?
Et, sans autre forme de procès, elle tourna les talons et se précipita hors de l’atelier. Joséphine, Faraldr et Liberté tournèrent vers lui des regards interloqués, comme s’ils le pensaient encore capable d’expliquer les lubies de sa cousine. Avec un haussement d’épaules, il se contenta de la suivre ; les autres, trop curieux, lui emboîtèrent rapidement le pas.
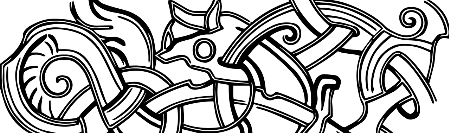
La salle dans laquelle les conduisit Armand se trouvait à l’avant-dernier étage de la maison. Faraldr avait encore du mal à se faire à ces immenses bâtisses pourvues de tant d’escaliers – et surtout au fait qu’elles n’étaient pas le seul apanage de puissants rois. Il commençait à se douter que, même pour cette époque, la famille de Mathilde devait être particulièrement riche ; ils n’étaient pas de simples marchands non plus, mais faisaient partie de la noblesse du pays. Cependant, lorsqu’ils étaient allés rencontrer l’Empereur de France, il avait noté que Mathilde et son père, qui les avaient accompagnés, n’étaient pas traités avec une dévotion particulière. Pas de la haute noblesse, donc.
Il avait encore bien des choses à apprendre, mais il commençait à cerner un peu mieux comment cette société s’organisait.
Au troisième étage, la maison devenait moins imposante : les couloirs étaient plus petits, les plafonds plus bas et les dorures et divers objets qui ornaient les salles d’apparat disparaissaient complètement. On s’approchait sans doute de l’endroit où dormaient les domestiques.
Cependant, la salle dans laquelle ils retrouvèrent enfin Mathilde ne ressemblait à rien de ce à quoi il s’attendait.
Elle était plus grande qu’une simple chambre à coucher, et ne contenait de toute manière pas de lit. Plusieurs petits bureaux et des tabourets étaient disposés devant une plus grande table. Sur les murs se trouvaient des images – pas des tentures, plutôt des tableaux sur des toiles et du papier, comme les portraits des ancêtres dans la longue galerie. Certains représentaient des cartes, comme dans les atlas à bord du vaisseau volant, et Faraldr s’approcha de l’une d’elle, à la recherche des formes qu’il avait mémorisées comme représentant la France et l’Islande. Puis il se plongea dans la contemplation d’un dessin de squelette, intrigué par cette représentation macabre. Il était orné de flèches et de mots – peut-être, finit-il par réaliser, des explications. Il s’en détourna, perdant tout intérêt pour ces mots qu’il était incapable de déchiffrer. Mathilde était occupée à examiner des étagères de livres : elle en avait un ouvert entre les mains, mais cela ne semblait pas lui suffire, car elle était déjà en train d’examiner d’autres couvertures. Joséphine et Liberté étaient penchées sur une sorte de boule perchée sur un trépied, qui semblait ornée également de cartes. Armand, quand à lui, s’était penché vers un des petits bureaux et semblait s’amuser de quelque chose.
Faraldr s’approcha du cousin de Mathilde dans le but de lui demander plus de précisions sur l’ouvrage qu’ils devaient chercher ; il ne servirait sans doute pas à grand-chose, mais il n’avait pas pour autant envie de rester sans rien faire.
— Alors, Faraldr, fit Armand en se redressant quand il le vit. Que penses-tu de notre salle d’étude ?
— Salle… d’étude ?
C’était également le mot que Mathilde avait utilisé, mais il ne pensait pas l’avoir déjà entendu.
— C’est là que les précepteurs venaient nous prodiguer leurs cours, lorsque nous étions enfants… Pardon, se reprit Armand en secouant la tête. Quand nous étions petits, des… personnes venaient ici pour nous apprendre à lire, à écrire, nous parler du monde…
— Des moines ? demanda Faraldr en pensant à ce qu’il avait appris des mœurs à la cour du Jarl de Normandie.
— Non, pas des moines, s’esclaffa le Français. Enfin… mais non. Ce sont… des sortes de domestiques. Les familles les payent pour enseigner aux enfants.
— Les familles riches, lâcha Joséphine. Pour les pauvres, c’est l’école avec les bonnes sœurs.
Faraldr fronça les sourcils et essaya de ne rien perdre de la conversation, tandis que Liberté, Armand et Joséphine se mettaient à discuter des différentes choses que l’on enseignait aux enfants à présent. Des savants domestiques, qui venaient apprendre aux enfants ce qu’ils devaient savoir à la place de leur famille… sans doute payés à ne faire que cela ; il commençait à se rendre compte que chaque serviteur avait une tâche bien précise à accomplir, dans les nobles maisons du XIXe siècle. C’était d’un luxe auquel il avait du mal à se faire.
Il comprenait mieux à présent comment Mathilde avait pu devenir aussi savante.
— Oh, Mathilde, regarde ! s’exclama soudain Armand en allant s’accroupir au pied d’une étagère.
Lorsqu’il se redressa, il tenait une petite boîte, peinte de couleurs vives. Faraldr plissa les yeux en voyant le sourire qu’il arborait. C’était une expression qu’il lui avait déjà vue ; en général, elle n’annonçait rien de bon quant à ses intentions – et se soldait le plus souvent par un soupir exaspéré de la part de Mathilde.
Cette fois, celle-ci ne se contenta pas de soupirer : elle plaqua les deux livres qu’elle avait à la main contre sa poitrine, écarquilla les yeux d’un air horrifié et cria :
— Armand, je t’interdis !
Mais son cousin ouvrait déjà la boîte tandis qu’elle finissait sa phrase dans un cri inarticulé. Un bruit s’éleva soudain – une sorte de mélopée qui semblait sortie de nulle part. Faraldr se tourna vivement, cherchant l’origine de la musique, jusqu’à réaliser qu’il ne pouvait provenir que d’un endroit : la boîte. Était-ce un sort ?
Mathilde avait l’air partagée entre l’horreur et la colère et Faraldr n’attendit pas plus longtemps. Quoi que ce soit, ça n’avait rien de naturel, et il était de son devoir d’agir. Il rejoignit Armand en deux enjambées et lui arracha la boîte dans le but de la fermer ; mais le bras mécanique qui remplaçait sa main droite ne lui obéissait pas encore pleinement. La boîte lui échappa pour tomber au sol dans un fracas métallique. La mélodie s’arrêta un instant avant de reprendre – mais elle avait à présent quelque chose de discordant. Faraldr contempla la chose, effaré.
Enfin Mathilde les rejoignit et se baissa pour ramasser la boîte, qu’elle reposa sur un des petits bureaux avant de la refermer d’un coup sec. La musique continua quelques instants encore, étouffée, comme si rien ne pouvait plus l’arrêter à présent que le sort avait été lancé ; puis, enfin, le silence se fit.
Furieux d’avoir une nouvelle fois fait preuve de maladresse, Faraldr serra les dents. On entendit un cliquetis lorsque le poing de son inutile prothèse se referma, sans même qu’il l’ait voulu. Le guérisseur qui venait régulièrement le voir pour lui apprendre à se servir de ce bras métallique disait qu’il progressait, mais lui n’était pas de cet avis. Il lui semblait qu’il n’arriverait jamais à contrôler ses gestes. Une fois de plus, il fut tenté de retirer cette chose qui ne lui apportait rien, si ce n’est des douleurs régulières au niveau de son moignon.
— Enfin, Armand, soupira alors Mathilde.
Son cousin prit un air outré, mais elle se tourna vers Faraldr sans lui prêter la moindre attention.
— Je suis désolé, dit-il. Je ne voulais pas…
Il s’arrêta, les yeux fixés sur la boîte. Il ne comprenait toujours pas ce qu’il s’était passé, au juste ; mais il commençait à réaliser qu’il s’était sans doute laissé emporter d’une manière qui n’était pas nécessaire.
— Ce n’est rien. Juste une vieille boîte à musique. Elle est solide, je suis sûre qu’elle n’est même pas cassée… Dieu sait que j’ai essayé assez souvent de m’en débarrasser, marmonna Mathilde en jetant un regard peu amène à la boîte.
— Est-ce… dangereux ?
Elle releva vers lui des yeux surpris.
— Oh, non. Pas le moins du monde, c’est juste… c’est une machine qui fait de la musique. Enfin, si on peut appeler ce son atroce de la musique.
— Oh, mais c’est si joli, laissa échapper Liberté.
Elle s’était approchée et examinait la boîte sans la moindre crainte. La voir si près de cet objet dont il se méfiait encore tendit instinctivement Faraldr, mais il ravala sa réaction et se contenta d’observer.
— C’est une l’épée ! s’exclama Joséphine.
Faraldr fronça les sourcils. Avait-il mal compris ?
— Il s’agit du nom de la fabrique qui confectionne ces boîtes, lui expliqua Mathilde, dans le mélange d’islandais et de norrois qu’ils utilisaient entre eux. Il y a un mécanisme à l’intérieur qui produit de la musique… ça n’a rien de dangereux.
Ce n’était pas la première fois qu’il se sentait idiot, mais comme toujours, cela lui fit grincer des dents. C’était sans doute ce qu’il détestait le plus dans sa situation : le nombre de fois où ce qu’il ignorait le poussait à se ridiculiser.
— Pardonne-moi.
— Il n’y a rien à pardonner. Tout ça parce qu’Armand voulait me faire une plaisanterie…
— Comment ça ?
— Quand j’étais petite, je détestais cette musique. Une de nos gouvernantes en était folle, elle la passait sans cesse…
Faraldr releva les yeux vers Armand, qui les regardait, les sourcils froncés. Sans doute avait-il entendu son nom dans la bouche de Mathilde. Le Français, malgré ses efforts, ne maîtrisait toujours que quelques phrases d’islandais ; ne pas comprendre ce qu’ils disaient l’agaçait toujours, même s’il faisait de son mieux pour le dissimuler.
Il sourit avant de se tourner vers Mathilde pour continuer leur conversation, sans lui demander de repasser au français, comme il comptait le faire. Armand méritait de mariner encore un peu.
— Comment est-ce que la boîte fonctionne ?
— Eh bien… pour être honnête, je ne me suis jamais penchée sur le détail. Mais c’est le moment ou jamais. Joséphine ?

Liberté était en extase devant la boîte à musique, évidemment. Elle n’oserait pas la rouvrir, pas après la scène à laquelle ils avaient eu droit à l’instant, mais elle l’examinait dans ses moindres détails, avec des yeux comme des soucoupes.
Joséphine était en train d’hésiter à tourner elle-même la manivelle, quitte à provoquer à nouveau le Viking, quand Mathilde s’approcha.
— Joséphine ? Pensez-vous pouvoir démonter cette boîte ?
Liberté releva aussitôt ses grands yeux de faon et Joséphine dut retenir un mouvement de recul. Même si sa petite sœur n’était pas autant en adoration devant cette boîte, elle aurait hésité : c’était quand même une boîte à musique Lépée. Ils étaient célèbres pour la qualité de leurs produits, elle en avait déjà entendu parler ; la désosser, c’était risquer de ne pas pouvoir la reconstituer ensuite.
Évidemment, ce n’était pas quelque chose qui avait dû traverser l’esprit de Mathilde. Elle était assez riche pour pouvoir se payer une cargaison de produits Lépée sans avoir à y réfléchir à deux fois. Sans compter que, vu sa tête quand Armand avait remonté la manivelle, elle n’avait pas l’air de beaucoup apprécier les boîtes à musique.
Typique. C’était toujours ceux qui avaient tout qui n’appréciaient rien.
— Si vous en voulez pas… je pourrais peut-être la récupérer, plutôt que de la démonter ? essaya-t-elle, les dents serrées.
Elle détestait mendier ainsi, mais Liberté n’oserait jamais ; et si elle pouvait faire plaisir à sa petite sœur, elle n’était pas au-dessus de demander. Et puis, avec Mathilde, c’était quand même moins terrible qu’avec une vraie patronne.
— Oh, non… Je voulais simplement expliquer à Faraldr comment elle fonctionne, et je pense que le mieux serait de lui montrer. Mais peut-être serait-il possible de la remonter ensuite ? Bien sûr, vous pourrez la prendre, Liberté, je vous en prie.
— Merci beaucoup, mademoiselle.
Mathilde se mordilla la lèvre et Joséphine retint un rire. Liberté appliquait toutes les convenances et les règles de bienséance à la lettre – encore plus à présent qu’elle était passée au service de mademoiselle de Haurecourt, qui était si courtoise qu’on l’aurait crue sortie d’un livre. Depuis qu’ils étaient rentrés d’Islande, elle avait remarqué que Mathilde semblait toujours mal à l’aise face à Liberté, et elle avait fini par comprendre que c’était cette politesse sans faille qui la mettait sur des charbons ardents. Apparemment, mademoiselle d’Amoys junior n’avait pas l’habitude qu’on la traite comme la dame qu’elle était.
Enfin, qu’elle était censée être.
— Bon, lâcha Joséphine en se penchant pour examiner la boîte. On peut jeter un œil, mais si je me sens pas de remonter le mécanisme, je vous préviens, je le touche pas. Gâcher du bon boulot, ça se fait pas.
— Vous ferez bien ce que vous voulez, comme toujours, marmonna Armand dans sa barbe inexistante.
Joséphine lui décocha son plus beau sourire avant de s’asseoir pour ouvrir la boîte. Tout le monde se rapprocha tandis qu’elle examinait les entrailles de l’objet avant de faire signe à Faraldr.
— Tiens, viens voir. Tu vois la manivelle, là ? Quand je la tourne, elle remonte un ressort… attends, je peux enlever ce cache. Ah, voilà. Tu vois ? Donc, on remonte le mécanisme. Maintenant, regarde bien, une fois que tout est remonté, je lâche…
La bobine ponctuée de minuscules trous se mit aussitôt à tourner, entraînant à sa suite les roues dentées qui appuyaient sur de fines lames. C’était d’une délicatesse incroyable. Elle montra à Faraldr les différents éléments, en faisant de son mieux pour ignorer les grimaces que se faisaient Mathilde et Armand derrière lui. Elle plaignait les pauvres précepteurs qui avaient dû les supporter : ça n’avait pas dû être facile tous les jours.
Faraldr marmonnait quelque chose dans sa barbe en fixant l’intérieur de la boîte, les sourcils froncés. Joséphine la lui tendit, mais il secoua la tête, la main gauche crispée sur son pendentif.
— Ça va pas te mordre.
— Je sais, s’indigna-t-il aussitôt. Je ne veux pas… chuter. Encore.
— Hein ?
— Vous voulez dire la faire tomber ? intervint Liberté.
— Oui. Faire tomber ?
— C’est ça.
Liberté mima l’action et Faraldr hocha la tête. En-dehors de Mathilde, sa petite sœur était sans doute celle qui comprenait le mieux le Viking quand il avait du mal à trouver ses mots. Enfin, pas que ça arrivait souvent ; depuis qu’ils étaient rentrés, il semblait plus déterminé que jamais à apprendre le français. À ce rythme, il parlerait couramment d’ici la fin de l’année.
Bon, avec un accent normand, peut-être. Mathilde et Armand parlaient évidemment comme des Parisiens et Liberté et elle avaient perdu leur accent créole depuis longtemps ; mais Faraldr passait beaucoup de temps chez les métayers et elle avait remarqué que ça déteignait sur lui. La dernière fois qu’il avait réclamé « à bér’ » plutôt qu’à boire, elle avait cru que Julie allait faire une syncope. La pauvre gouvernante mettait un point d’honneur à parler un bon français et elle considérait le Viking comme un véritable seigneur : l’entendre parler comme un fermier avait été un sacré choc.
— Voilà, c’est tout, finit-elle en reposant la boîte à musique sur la table. Rien de bien sorcier.
— Un grand savant a fabriqué cette boîte, fit observer Faraldr, qui la contemplait à présent d’un air plus admiratif que méfiant.
— Ça, c’est sûr.
— N’exagérons rien, les interrompit Mathilde avec une moue. Ces boîtes à musique étaient certes ingénieuses il y a un siècle, mais maintenant elles n’ont plus rien d’innovant.
— Ça reste du bon travail. Ceux qui font les bobines ont pas intérêt à se louper s’ils veulent pas produire de fausses notes.
— La musique… hasarda Faraldr. Elle est comme ça maintenant ? Dans des boîtes ?
— Oh, non. Il y a toujours des instruments, bien sûr. Nous faisons maintenant des concerts dans des salles… comment dire…
Mathilde repassa à leur charabia et Joséphine cessa de prêter attention à ce qu’elle racontait le temps de remettre tout correctement en place dans la boîte ; puis elle la referma et la tendit à Liberté avec un sourire. Sa petite sœur la prit dans ses bras avec autant de précautions que s’il s’agissait d’un nouveau-né ; Mathilde lui accorda à peine un regard, sans interrompre sa discussion avec Faraldr. Évidemment, pour elle, une simple boîte à musique ne représentait rien… mais c’était quand même gentil de sa part de la donner à Liberté.
C’était quelqu’un de bien. Même si ses monologues étaient parfois de vrais étouffe-chrétien. D’ailleurs, il était peut-être temps de voler au secours de Faraldr : il écoutait toujours avec attention, mais Joséphine était sûre que, parfois, même lui devait finir par perdre le fil.
— Et vous, vous faisiez quoi, comme musique ? Des veillées ? Des chants ?
Ça eut le mérite d’interrompre net Mathilde. C’était trop facile : la seule chose qu’elle aimait plus qu’expliquer à Faraldr les nouveautés de leur siècle, c’était l’écouter, lui, parler de comment les choses étaient à son époque.
— Des chants, oui. Nous avons… avions des… instruments ?
Il tenta de mimer plusieurs instruments différents et Joséphine se retint vaillamment de rire devant le spectacle de ce bonhomme imposant en train de souffler dans une flûte imaginaire. Liberté se tenait, comme d’habitude ; Armand, en revanche, dut se détourner, une main plaquée sur la bouche. Lui, il allait se prendre une rouste par Mathilde, s’il ne se méfiait pas.
— Oh, et si nous faisions une veillée ? lança alors Liberté. Ce serait amusant, non ? Nous pourrions jouer de la musique et Faraldr pourrait nous faire découvrir des chants de son temps !
— Quelle merveilleuse idée ! s’exclama aussitôt Mathilde. Il faudrait aller voir au grenier, je suis presque sûre qu’il doit y avoir des instruments de musique là-haut… ils ne seront peut-être pas en très bon état, mais avec un peu de chance…
Elle et Liberté se mirent aussitôt en devoir de préparer leur soirée ; Joséphine aurait eu du mal à dire laquelle était la plus enthousiaste. En tout cas, elle avait hâte de voir la tête qu’allait tirer Henriette d’Amoys devant cette invasion musicale de son salon.
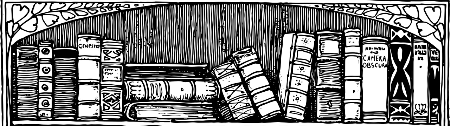
Ils trouvèrent au grenier une ou deux flûtes, un violon en piteux état et même une impressionnante harpe, à laquelle il manquait cependant la moitié de ses cordes. Liberté s’essaya tout de même à en tirer quelques sons, même s’il fallut l’encourager. Contrairement à Joséphine, elle semblait toujours craindre de déranger.
Mathilde avait conscience que leur place à toutes les deux n’était pas des plus traditionnelles. Après tout, elles faisaient partie de la maisonnée de sa tante et percevaient un salaire au même titre que les autres domestiques ; mais depuis qu’ils étaient rentrés d’Islande, la position de Joséphine avait indéniablement changé. Elle passait autant de temps dans les salons ou la bibliothèque du manoir avec Armand, Faraldr et elle, à planifier leurs voyages à venir, que dans son domaine habituel des dépendances. Liberté les rejoignait parfois lorsqu’elle avait fini ses tâches pour Anne-Marie, et Mathilde savait d’ailleurs que cette dernière l’encourageait en ce sens ; mais les deux sœurs retournaient toujours dans les quartiers des domestiques pour prendre leurs repas et dormir.
Tout ceci était fort peu orthodoxe ; et encore, ils se trouvaient dans le cadre plus tranquille du domaine de province, et en l’absence de sa mère… si Emma d’Amoys avait été présente, Mathilde n’osait imaginer ce qu’elle aurait pensé de voir une mécanicienne et une demoiselle de compagnie installées dans la bibliothèque avec un invité de marque comme Faraldr.
Elle regarda celui-ci rejoindre Liberté, puis s’essayer à son tour à la harpe de la main gauche. Impossible de le considérer comme un simple invité ; il faisait partie intégrante de la maisonnée.
Avant qu’elle n’ait eu plus de temps pour s’appesantir sur cette idée, un raffut terrible la fit violemment sursauter. Armand, affublé d’un tambour passé en bandoulière, arpentait le grenier en faisant un vacarme assourdissant.
— Pitié, cesse donc !
— Tu aurais détesté les réveils militaires, lui lança-t-il, marquant ses mots d’une nouvelle salve de ses baguettes.
— Je te préviens, si tu comptes réveiller qui que ce soit avec cet engin, je te dénoncerai immédiatement à tante Henriette.
— Mathilde, tu me blesses…
Il ôta cependant la lanière du tambour et le reposa à côté du reste de leur butin avant de s’épousseter les mains en grimaçant. Amusée de sa délicatesse, elle vint se saisir d’une partie des instruments – l’obligeant par là même, galant qu’il était, à lui reprendre son fardeau. Comme elle s’y attendait, c’est ce qu’il fit, non sans un long soupir.
— Allons, redescendons, lança-t-elle aux autres. Je pense que le repas va bientôt être servi.
Durant l’après-midi, elle retourna explorer la salle d’étude et parvint enfin à mettre la main sur le fameux livre qui avait lancé toute cette aventure : les Récits édifiants de la chrétienté à destination des enfants. Elle fut cependant déçue en le feuilletant : le récit de la vie de Sainte Lucie s’y trouvait bien, mais l’explication de la célébration qui en était faite dans les pays scandinaves tenait en quelques lignes. Il faudrait qu’elle demande au professeur Martel s’il avait d’autres textes sur le sujet.
Elle partit alors à la recherche de ses compagnons, mais ne trouva personne. Armand était parti rendre une visite – elle avait craint que la fin de sa carrière dans l’armée ne porte un coup à ses relations avec le voisinage, mais tout le monde était bien trop curieux de leurs aventures islandaises et sa compagnie était sans doute plus demandée encore qu’auparavant. Liberté tenait compagnie à Anne-Marie et à sa tante ; Joséphine était occupée à faire une révision sur l’automobile de la maisonnée. Faraldr, quant à lui, se révéla introuvable : sans doute était-il parti se promener.
Elle finit donc par aller se réfugier dans la bibliothèque, non sans s’étonner de réaliser que, pour une fois, elle aurait sans doute préféré la compagnie de quelqu’un plutôt que celle de livres. Bien sûr, elle s’empressa de se plonger entre les pages pour conjurer cette impression déstabilisante. Elle n’en émergea à nouveau que lorsqu’on vint l’appeler pour le repas du soir.
Elle en avait presque oublié le projet de veillée lancé plus tôt ; mais pas ses compagnons. Dès la fin du repas, Armand se leva pour venir s’incliner devant Anne-Marie et tante Henriette.
— Mesdemoiselles, nous avons le plaisir de vous proposer ce soir un interlude dans la plus pure tradition normande : une veillée musicale !
Mathilde eut l’impression de voir, littéralement, la réplique caustique se former sur les lèvres de sa tante… mais fort heureusement, Anne-Marie prit la parole la première.
— Oh, quelle merveilleuse idée ! Allons, Henriette, ne fais pas cette tête. Voilà bien trop longtemps que je ne t’ai pas entendue jouer.
Sa tante grommela, mais se leva tout de même sans protester. Faraldr, qui semblait guetter ce moment, s’empressa de lui proposer son bras gauche ; Armand fit de même pour Anne-Marie, mais lorsqu’il fit mine de tendre son autre bras à Mathilde, elle leva les yeux au ciel et lui passa devant sans s’arrêter. Elle était tout de même capable de trouver seule le chemin jusqu’au petit salon.
Joséphine et Liberté s’y trouvaient déjà, ainsi que les instruments dénichés au grenier, qui avait visiblement été nettoyés et cirés durant l’après-midi ; le violon avait presque l’air présentable à présent, même si elle ne donnait pas cher du son qu’il pourrait produire. Mathilde alla prendre place à côté de la mécanicienne, non sans une certaine trépidation, car elle était absolument dépourvue du moindre talent musical. Sa mère avait insisté pour qu’elle suive des leçons de piano-forte durant plus de dix ans, avant de finir par se résoudre au fait qu’il valait mieux tenir sa fille à l’écart du moindre instrument de musique, surtout en société.
Cela ne l’empêchait pas, cependant, d’apprécier le talent de ceux qui en étaient pourvus.
Faraldr se plaça devant la cheminée éteinte. Anne-Marie lui avait fait faire de nouveaux vêtements à Caen récemment. Avec son gilet de soie rouge brodé de fil d’or et sa cravate fine, il ressemblait à n’importe quel homme du monde – mais il y avait toujours quelque chose chez lui, sur lequel elle n’aurait su mettre le doigt, qui le distinguait. Peut-être était-ce la barbe qu’il entretenait soigneusement, mais qui ne correspondait pas à la mode du moment ; ou la façon qu’il avait de rester le plus souvent silencieux, à observer tout ce qui l’entourait de son regard perçant, à écouter attentivement, sur le qui-vive. Sa prothèse le singularisait également, même si on la voyait à peine ; il avait catégoriquement refusé la chemise à manche droite raccourcie que lui proposait le tailleur pour la mettre en valeur. C’était peut-être la grande tendance, mais l’idée même avait semblé le choquer et personne n’avait insisté.
— Chez moi, commença-t-il après s’être raclé la gorge, nous aimons nous rassembler souvent. Nous allons dans les grandes maisons pour… veiller. Et nous aimons la musique. Nous aimons beaucoup.
Il parlait lentement et Mathilde se demanda s’il n’avait pas préparé ce discours durant l’après-midi.
— Nous… faisons la musique à tour de rôle. D’abord, la maîtresse de la maison. S’il vous plaît, mademoiselle d’Amoys ?
— Je ne voudrais pas déroger à la tradition, mais je suppose qu’en tant que maîtresse de la maison, je puis réclamer de l’assistance ?
Faraldr marqua un temps d’arrêt, puis acquiesça – Mathilde le soupçonnait de ne pas avoir tout compris, mais de ne pas vouloir s’opposer à sa tante, ce qui était toujours une sage décision. Tante Henriette sourit.
— Dans ce cas… Anne-Marie, si tu veux bien ? Et… voyons, il nous faut une voix plus grave. Monsieur du Thouars, faites-nous donc cet honneur.
Sans attendre, elle alla prendre place au piano-forte. Anne-Marie installa la partition devant elle, puis murmura quelque chose à Armand, qui s’était presque mis au garde-à-vous à ses côtés.
Le silence se fit ; puis les premières notes retentirent. Mathilde ne tarda pas à reconnaître le morceau : il était extrait du Tristan und Isolde de Wagner qui avait connu tant de succès l’an passé. Elle ignorait que sa tante s’en était procuré la partition, et frissonna d’avance pour Armand, qui allait devoir déchiffrer les paroles en allemand à la volée… mais son cousin s’en tira tout à fait honorablement, même si sa voix ne valait pas celle d’Anne-Marie. Après tout, cela n’aurait pas dû l’étonner : elle l’avait toujours vu participer avec plaisir aux interludes musicaux lors des soirées, qu’elles soient seulement familiales ou regroupent tout le voisinage.
En fait, le souvenir de ces soirées, avec leur brouhaha feutré de conversations et les félicitations toujours mesurées que l’on accordait aux interprètes, était si vivace dans son esprit qu’elle fut surprise lorsque Joséphine se mit à applaudir à la fin du morceau. Faraldr ne fut pas en reste, scandant des « très beau » d’une voix forte à défaut de pouvoir imiter la mécanicienne. Liberté, à côté d’eux, semblait mortifiée par ce comportement qui n’aurait pas déparé dans une auberge, mais Mathilde décida de suivre le mouvement et applaudit à son tour. Après tout, c’était censé être une veillée traditionnelle ; elle calquerait son comportement sur celui de Faraldr.
Anne-Marie, si elle fut surprise, n’en laissa naturellement rien paraître et se contenta d’esquisser une révérence. Il y eut ensuite un moment de flottement, puis tante Henriette prit les devants.
— Eh bien, monsieur Helgusson. Que pensez-vous de notre musique ?
— Très beau, répéta-t-il sans hésiter. Différent de ce quoi je connais, mais… magnifique ? Magnifique.
— Mathilde, cet homme a du goût ! Il faudra l’emmener à l’opéra.
— Nous n’y manquerons pas, ma tante.
En vérité, elle n’y avait jamais pensé, mais nota intérieurement de se pencher sur la question dès le lendemain.
— Toutes les chansons sont comme cela ? reprit alors Faraldr.
Les Français échangèrent un regard ; Mathilde fut prise de tournis à l’idée de faire le tour de neuf siècles de tradition musicale avec leurs faibles moyens… fort heureusement, Joséphine intervint.
— Ah, non ! Ça, c’est de la musique de la haute. Si tu vas dans les usines ou dans les champs, c’est autre chose…
— Il y a aussi les berceuses et les comptines pour enfants, ajouta Liberté.
— Les marches militaires.
— Les hymnes religieux.
— La musique de bal, également : les quadrilles, les contredanses…
— Les bourrées…
— Oh, et les valses !
Ils se mirent en devoir d’offrir à Faraldr un aperçu du vaste répertoire musical français. Armand les entraîna dans un célèbre chant à répondre de la marine, ce qui valait sans doute mieux qu’une chanson à boire ; Joséphine interpréta des chansons populaires, dont la Carmagnole, mais dut renoncer à la Marseillaise devant l’air horrifié d’Anne-Marie ; tante Henriette plaqua quelques accords de la Parisienne, plus acceptable. Ils apprirent à Faraldr les paroles d’Au Clair de la Lune, puis Liberté leur fredonna une berceuse créole. Mathilde réussit durant tout ce temps à éviter de se retrouver au centre de l’attention, mais les regards finirent par se tourner vers elle. Heureusement, elle était prête.
— Et toi, Faraldr ? J’aimerais beaucoup découvrir de la musique de chez toi.
Au moment où elle posait la question, il lui vint à l’esprit qu’elle était peut-être malvenue : et si cela lui donnait le mal du pays ? Mais il sourit sans montrer la moindre trace de mélancolie.
— Je peux vous chanter le combat de Sigurðr contre le géant Starkaðr. Je voudrais traduire, mais…
— Te bile pas, lâcha Joséphine. Mathilde nous expliquera bien, après.
Tous reprirent leur place tandis que Faraldr allait s’asseoir sur le banc du piano-forte. Il s’installa cependant dos au clavier et cala entre ses genoux le tambour, sur lequel il se mit à battre un rythme lent de la main gauche.
Puis il commença à chanter et Mathilde se laissa transporter. Ce n’était presque pas un chant à proprement parler ; il parlait… mais pas vraiment non plus, car il scandait les mots, et la poésie des allitérations et du rythme faisait naître une mélodie soulignée par le battement sourd du tambour. C’était d’une simplicité qui rappelait la vision romantique de l’antiquité païenne ; mais en même temps, les kennings traditionnels qui composaient le chant étaient d’une subtilité extrêmement sophistiquée.
Le rythme qu’il imprimait à l’instrument s’accéléra imperceptiblement à mesure de l’histoire, jusqu’à culminer lorsque le héros parvint à vaincre son monstrueux adversaire. Lorsqu’il reposa enfin sa main à plat sur son genou, le silence régna quelques instants. Mathilde remarqua comme son regard semblait perdu au loin – elle ressentit une terrible compassion pour la manière dont son époque devait lui manquer.
Puis les applaudissements retentirent à nouveau, les compliments fusèrent et le Normand retrouva toute sa bonne humeur, teintée d’une fierté méritée. Il leur apprit ensuite une chanson à répondre qui était utilisée pour rompre la monotonie des travaux des champs, dont ils réussirent tous à maîtriser rapidement le refrain. Il faudrait, se dit Mathilde, qu’elle aille faire quelques recherches auprès des métayers du domaine, pour voir si de telles traditions scandinaves avaient pu survivre dans leur quotidien.
Elle mit toutefois ces considérations de côté. Elle aurait tout le temps pour interroger Faraldr sur son époque et pour approfondir ses connaissances ; pour l’instant, elle ne voulait qu’apprécier sa compagnie, en toute simplicité.
Elle joignit sa voix au chœur général ; et si elle chanta faux, eh bien, personne ne lui en fit la remarque.
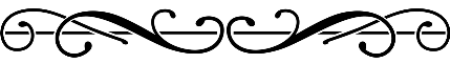
J’espère que vous avez passé un bon moment en Normandie ! N’hésitez pas à venir discuter instruments, musique et chants en commentaire.
